REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix – Travail – Patrie Peace – Work – Fatherland
—————- —————- 
COUR SUPREME SUPREME COURT
———- ———–
REQUISITIONS DE MONSIEUR LE PROCUREUR
GENERAL PRES LA COUR SUPREME
A L’AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTREE
DE LA COUR SUPREME
23 février 2016
Par Luc NDJODO
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR SUPREME
Je vous remercie, Monsieur le Premier Président, de l’occasion que vous m’offrez de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour les réquisitions du Ministère Public en cette audience solennelle de rentrée de la Cour Suprême organisée au titre de l’année judiciaire 2016 qui commence.
Monsieur le Président du Sénat,
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le parquet Général près la Cour Suprême vous souhaite la bienvenue dans cette salle d’apparat de la Haute Cour.
Il vous sait gré d’avoir accepté de délaisser vos importantes et si absorbantes occupations pour honorer cette rencontre de votre présence.
Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
C’est toujours avec la même fierté que nous vivons votre présence dans cette salle où vous êtes chez vous.
Nous vous sommes infiniment reconnaissants de l’honneur qui nous est ainsi fait.
Monsieur le Vice Premier Ministre, Ministre Délégué à la Présidence de la République Chargé des Relations avec les Assemblées,
Nous vous accueillons avec joie et vous remercions pour l’estime que vous avez toujours accordée au service public de la Justice.
Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre du Tourisme et des Loisirs,
Mesdames et Messieurs les Ministres, Ministres Délégués et Secrétaires d’Etat,
Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Hauts Commissaires et Représentants des Organisations Internationales,
Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre,
Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Yaoundé,
Mesdames et Messieurs les Chefs des Cours d’Appel et du Tribunal Criminel Spécial,
Mesdames et Messieurs les Présidents des Tribunaux Administratifs Régionaux,
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun,
Madame le Président de la Chambre Nationale des Notaires,
Monsieur le Président de la Chambre Nationale des Huissiers,
Mesdames et Messieurs,
Honorables invités,
Le parquet Général près la Cour Suprême vous remercie d’avoir accepté de répondre à l’invitation qui vous a été adressée.
La traditionnelle rencontre qui nous réunit ce jour a pour fondement l’article 33 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.
En cette occasion particulière, vous voudrez bien me permettre d’aborder avec vous une réflexion sur un thème plusieurs fois débattu parce qu’il touche en grande partie à la perception de l’administration de la Justice par les usagers du service, par les populations et même par la communauté internationale, mais qui est toujours d’actualité, à savoir, la problématique des temps judiciaires.
En son article 10, la Déclaratio Universelle des Droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa Résolution n° 217 A(III) du 10 Décembre 1948 et ratifiée par la République du Cameroun le 20 Septembre 1960 proclame que :
« toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un Tribunal indépendant et impartial qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
En son article 6, la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 04 Novembre 1950 consacre le principe du règlement des litiges dans un délai raisonnable en affirmant que :
« toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Pour sa part, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée le 27 Juin 1981 à NAIROBI au KENYA lors de la 18è session de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine dispose en son article 7(1)
« toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :
a) Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ;
b) Le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ;
c) Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ;
d) Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. »
L’objet de la garantie d’un délai raisonnable qui est énoncée dans les textes lectures vient de vous être donnée, est de protéger tous les justiciables contre les lenteurs excessives de la procédure. Elle fait partie de celles des garanties que renferme le droit à un procès équitable, lequel droit est reconnu à toute partie au procès.
Cette garantie réaffirme l’importance qui s’attache à ce que la Justice ne soit pas rendue avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité.
Elle vise par conséquent à assurer aux parties que, dans un délai raisonnable et au moyen d’une décision de justice, il sera mis fin à l’incertitude dans laquelle se trouve plongée une personne quant à sa situation en droit civil ou quant à l’accusation en matière pénale portée contre elle.
Il convient de préciser que les garanties qui sous-tendent le droit à un procès équitable ne sont pas uniquement applicables à la procédure devant la barre.
Elles s’étendent également aux étapes qui la précèdent et qui la suivent.
En matière pénale, ces garanties concernent les enquêtes judiciaires menées par les services de police.
Les enquêtes doivent être menées dans un délai raisonnable, en même temps que seront respectés la présomption d’innocence, le droit à la défense, le droit à l’intégrité physique et plus généralement, l’ensemble des droits humains.
Ces garanties s’appliquent aussi à la procédure postérieure au procès, et notamment lors de l’exécution d’un jugement.
Le droit à un procès équitable serait illusoire si l’ordre public interne de l’Etat permettait qu’une décision de justice définitive, ayant l’autorité de la chose jugée, demeurât dépourvue de caractère exécutoire au détriment d’une partie.
Les temps judiciaires englobent donc le temps de la saisine de la Justice, le temps des enquêtes, le temps des débats, le temps des plaidoiries, le temps des incidents de procédure, le temps de la sentence, le temps des voies de recours et le temps de l’exécution de la décision.
Renvoyant les tribunaux à l’application des principes consacrés par les instruments internationaux ci-dessus rappelés, le droit interne de notre pays a mis en place des procédures judiciaires adaptées à la nature des affaires, lesquelles procédures par essence prescrivent des délais aux parties.
En matière du travail par exemple, et s’agissant des conflits individuels de travail, le législateur soumet préalablement les parties à une tentative de conciliation en disposant à l’article 139 de la loi n° 92/007 du 14 Août 1992 portant code du Travail que tout travailleur ou tout employeur doit demander à l’inspection du travail du lieu de travail de régler le différend à l’amiable.
En cas d’accord, un procès verbal de conciliation rédigé et signé par l’inspecteur du travail et les parties consacre le règlement amiable du litige, lequel procès verbal de conciliation devient applicable dès qu’il a été vérifié par le Président du Tribunal compétent et revêtu de la formule exécutoire.
En cas de conciliation partielle, le procès verbal mentionne les points sur lesquels l’accord est intervenu et ceux sur lesquels un désaccord persiste.
En cas d’échec de la tentative de conciliation, l’inspecteur du travail dresse un procès verbal de non-conciliation.
Dans tous les cas, un exemplaire du procès verbal signé par l’inspecteur du travail et par toutes les parties est adressé au Président du Tribunal compétent et remis aux parties.
Ces préalables sont impératifs, leur non-respect ayant pour conséquence la non recevabilité du recours intenté par le demandeur.
La jurisprudence a depuis longtemps souligné le caractère obligatoire de la tentative de conciliation.
La haute Juridiction casse par conséquent les décisions des juridictions de fond qui se prononcent favorablement sur des chefs de demande non soumis à la tentative de conciliation.
Elle les considère comme des demandes nouvelles.
En matière administrative, les articles 17, 18 et 19 de la loi n° 2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs disposent que le recours devant le Tribunal Administratif n’est recevable qu’après rejet d’un recours gracieux adressé à l’autorité auteur de l’acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l’établissement public en cause.
Le recours gracieux doit, sous peine de forclusion, être formé :
– Dans les trois mois de la publication ou de la notification de la décision attaquée ;
– En cas de demande d’indemnisation, dans les six mois suivant la réalisation du dommage ou de sa connaissance ;
– En cas d’abstention d’une autorité ayant compétence liée, dans les quatre ans à partir de la date à laquelle ladite autorité a été défaillante.
Les recours contre les décisions administratives doivent être introduits dans les 60 jours à compter de la décision de rejet du recours gracieux.
Ces délais courent du lendemain du jour de la notification à personne ou à domicile élu.
Les délais de recours sont prolongés si le requérant, dans l’intervalle, a disposé une demande d’assistance judiciaire ou saisi une juridiction incompétence.
Dans ce cas, le recours contentieux est valablement introduit dans les 60 jours qui suivent la notification de la décision statuant sur la demande d’assistance judiciaire ou sur la compétence.
Pour sa part, la procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour Suprême présente aussi ses spécificités.
Celles-ci tiennent notamment à l’application du principe du double arrêt, principe qui consiste pour la juridiction financière à prononcer un premier arrêt dit « arrêté provisoire de compte », lequel est rendu en l’absence du comptable incriminé.
Le premier arrêt précède la procédure judiciaire devant la barre, laquelle comporte entre autres, l’injonction préalable faite au comptable de justifier toutes les irrégularités observées dans son compte, le rapport subséquent du conseiller maître rapporteur et les conclusions du Ministère Public, le respect du contradictoire, le prononcé et la notification de l’arrêt définitif tant au comptable concerné qu’aux administrations intéressées.
Excellences, Mesdames et Messieurs
Dans un arrêt de principe rendu le 28 Juin 2002, le Conseil d’Etat français a jugé que :
« le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale compte tenu notamment de l’exercice des voies de recours, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et le cas échéant de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement… »
Il résulte de cette décision de principe que l’appréciation du caractère raisonnable d’un délai doit se faire au regard de divers critères, et notamment, le comportement des parties, le comportement des autorités judiciaires et administratives, ainsi que l’enjeu de la procédure pour le requérant.
La juridiction doit se pencher sur les circonstances particulières de la cause.
Certes, l’intuition du juge associée à ses connaissances juridiques et son expérience professionnelle, l’aide à trouver la solution au problème juridiction posé.
Mais, comme l’affirme Claude- Philippe BARRIERE, Magistrat à la retraite, dans son livre intitulé « DIEU en Justice » paru aux Editions ARSIS en 2009 :
Et je cite :
« La reconnaissance sentimentale ou intuition est indispensable pour les appréciations, mais non décisive, car la pensée doit élaborer ce qui a été perçu par l’intuition, ce qui implique nécessairement, après la phase intuitive de la pensée, la phase constructive, donc argumentée du raisonnement dont on ne peut faire l’économie ».
Fin de citation.
Le même auteur n’a pas résisté au plaisir de rappeler les dispositions de l’article 353 du Code de Procédure Pénale français dont la lecture est faite aux jurés des cours d’assises avant qu’ils se déterminent.
Ce texte dispose :
« La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : avez-vous une intime conviction ? »
Comme on peut le constater, ces dispositions ne fixent pas un délai absolu au juge pour le traitement de son dossier.
A la vérité, le temps nécessaire pour rendre une saine justice ne peut que très difficilement s’enfermer dans un calendrier étroit.
La complexité de l’affaire amène à donner de l’importance à la nature des faits à établir, au nombre des accusés et des témoins, à la dimension spatiale de l’affaire, à la jonction de plusieurs affaires et à l’intervention des tiers dans la procédure.
Le comportement des parties est aussi déterminant. Celles-ci sont tenues d’accomplir avec diligence les actes les concernant, de ne pas user de manœuvres dilatoires et d’exploiter les possibilités offertes par la loi pour abréger la procédure.
Mesdames et Messieurs,
Dans ECCLESIASTE, Chapitre 3, Versets 1à 8, la Bible enseigne, et je la cite dans sa version Louis SEGONG de 1910 :
« il ya un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux : un temps pour naître et un temps pour mourir ; un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté ; un temps pour tuer et un temps pour guérir ; un temps pour abattre et un temps pour bâtir ; un temps pour pleurer et un temps pour rire ; un temps pour se lamenter et un temps pour danser ; un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres ; un temps pour embrasser et un temps pour s’éloigner des embrassades ; un temps pour chercher et un temps pour perdre ; un temps pour garder et un temps pour jeter ; un temps pour déchirer et un temps pour coudre ; un temps pour se taire et un temps pour parler ; un temps pour aimer et un temps pour détester … »
A son tour, pour parvenir à une bonne justice, le juge a besoin de prendre du recul par rapport aux évènements qui se trouvent à l’origine du processus judiciaire.
Il a besoin du temps nécessaire à la maturation de ses décisions.
Le temps souvent considéré comme long observé dans la prise de décision est généralement la résultante de la nécessité du recul du juge par rapport à l’évènement, même si par ailleurs, ce temps représente aussi la manifestation de l’indépendance nécessaire et de la sérénité à garder dans la conduite des affaires.
Toutefois, le juge doit être un homme de son temps.
Il ne saurait oublier que les structures temporelles de la société et le rythme de vie influencent fortement les exigences des usagers vis-à-vis des services publics en général et de la Justice en particulier.
Ces exigences ont installé les temps judiciaires au centre de vifs débats et critiques.
« O temps suspends ton vol », écrivait Alphonse de LAMARTINE dans son poème intitulé « Le lac ».
Le poète faisait alors le constat d’un temps qui ne s’arrête pas, qui s’écoule continuellement, et n’est jamais suffisant pour permettre de mener à terme les projets, qui n’est pas toujours assez long pour la satisfaction de tous les besoins.
« Le temps c’est de l’argent », pense affirmer l’homme de situation en économique.
Plus on perd du temps, moins on a des chances de réaliser ses performances en matière économique, le temps restant à tout prendre, le régulateur des gains que l’on pourrait engranger au bout de l’effort.
Le temps demeure le baromètre de l’action, laquelle ne paraît souffrir aucun délai.
A l’heure où les justiciables se plaignent de l’engorgement des juridictions et des lenteurs des procédures, avec pour corollaire la surpopulation carcérale en matière pénale, la réflexion sur la temporalité de l’activité judiciaire est plus que jamais d’actualité.
Depuis des années, la Justice est l’objet de toutes les critiques, homme politiques, juristes, journalistes, organismes divers lui reprochent entre autres ses lenteurs, sa complexité, son hermétisme, l’insuffisance de ses moyens par rapport aux objectifs qui lui sont assignés.
Les lenteurs particulièrement sont dénoncées aussi bien par les justiciables désireux d’obtenir une réponse rapide à leurs demandes que par certains professionnels amenés à interagir avec l’institution judiciaire et par les médias qui y voient un insupportable décalage par rapport au rythme accéléré qu’eux- mêmes contribuent parfois à imposer.
Voici ce qu’en disait le Président de la République, son Excellence Paul BIYA dans son message à la Nation du 31 Décembre 1998 :
Je cite :
« il y a encore beaucoup d’exemples où la justice n’est pas rendue comme elle le devrait, c’est-à-dire avec célérité, avec impartialité, en conformité rigoureuse avec les lois et les procédures en vigueur … les dérèglements que l’on constate risquent de jeter la suspicion sur l’ensemble de l’institution, or celle-ci investie désormais du pouvoir judiciaire, en tire une responsabilité particulière … »
Fin de citation.
Le journal Cameroon Tribune n° 10946/7145 du 12 Octobre 2015, relayant la cérémonie d’installation survenue deux jours plus tôt du Procureur Général près le Tribunal Criminel Spécial, rapportait ainsi les propos tenus par le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux :
Je cite encore :
« Un ensemble de préoccupations sont exprimées à l’endroit du fonctionnement de nos juridictions. Elles ne sont pas nécessairement toutes fondées. Elles ne sont pas toutes exagérées».
Fin de citation.
Dans son commentaire, le même organe de presse explique que le Garde des Sceaux fustigeait ainsi.
« Des comportements anti-professionnels de certains magistrats à qui il exige la célérité dans le traitement des affaires ».
Dans une note de synthèse sur l’esprit du temps et l’accélération dans l’institution judiciaire en France et en Belgique, Benoît BASTARD, Sociologue français, membre de l’Institut des sciences sociales à l’Ecole normale supérieure de CACHAN en France et d’autres spécialistes, font le constat selon lequel :
« La justice conserve l’image surannée d’une institution marquée par les délais et les retards ».
Ces spécialistes professent que le nouveau rapport au temps que les sociétés modernes connaissent est à l’origine de l’exigence de réponses plus rapides, de délais de traitement des dossiers plus brefs.
Ils font découler cette exigence aussi bien de la modification profonde des rapports entre les institutions et leurs administrés que du renouvellement complet des conceptions relatives à la gestion des institutions.
Ils font valoir que la justice, à l’instar des autres administrations, a été touchée par le mouvement de modernisation ambiant et que la volonté de traiter rapidement les affaires apparaît comme l’expression de l’accélération du temps qui touche la société entière.
Mesdames et Messieurs,
Cet appel a été entendu sous d’autres cieux.
Ainsi, l’introduction en France du « traitement en temps réel » des affaires pénales démontre à suffire, que le principe d’une réponse rapide est devenu un leitmotiv adopté par l’institution judiciaire de ce pays afin de réagir aux critiques récurrentes dont elle était l’objet dans l’opinion publique.
Par ailleurs, face à l’accélération du traitement judiciaire du divorce en France et en Belgique, le résultat de la recherche effectuée en 2014 par les experts susvisés révèle que :
« Des propos recueillis des magistrats, il ressort la fierté que ces derniers manifestent de maintenir un tempo rapide ou d’innover sur ce plan et la satisfaction qui en résulte eu égard aux attentes supposées des usagers de la justice ».
Au Cameroun, en dépit du sursaut annoncé par la Cour Suprême, laquelle, à l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux aux Chefs de la Haute Cour le mardi 26 Janvier 2016, a signalé une augmentation quantitative de sa production judiciaire de presque cinquante pour cent par rapport à l’année précédente, il reste certes de nombreuses obsèques à franchir.
Des plaideurs manquent de collaboration notamment en ne produisant pas les documents portant plusieurs fois réclamés par les juges.
C’est aussi le cas de témoins qui ne comparaissant pas, obligent les juges à renvoyer les affaires.
Il est également fait grief à certains Avocats de sombrer dans le dilatoire et d’utiliser toutes les techniques d’endiguement des procédures en sollicitant des renvois ou des rabattements de délibéré injustifiés.
Les serviteurs de la justice autres que les magistrats ne sont pas en reste.
Des Greffiers, des Huissiers de justice, des Officiers de police judiciaire, des experts portent parfois le blâme de l’inaccomplissement ou de l’accomplissement insatisfaisant des diligences nécessaires à la préparation d’une décision judiciaire ou à la production d’une Justice de qualité.
Au vu de tout ce qui précède, il est constant que les temps judiciaires n’appartiennent en totalité, ni à l’institution judiciaire, ni aux usagers.
Ils devraient plutôt permettre entre eux une interaction.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Dans la quête du dénouement heureux de son affaire, l’impatience du plaideur qui se mêle parfois à de l’anxiété devrait cependant intégrer que le temps nécessaire pour y parvenir ne dépend pas des seuls magistrats.
Tous les acteurs de la chaîne judiciaire y contribuent.
Le temps nécessaire au règlement des procédures judiciaires n’a par conséquent jamais été simple. Il dépend des éléments d’ordre professionnel et des contraintes d’ordre structurel organisationnel et humain.
Et comme l’a affirmé Monsieur Marcel MENDY, le porte-parole des Chambres Africaines Extraordinaires de DAKAR le 28 Octobre 2015 au cours du procès de l’ancien Président de la République du Tchad, Monsieur HISSENE HABRE :
« Le temps judiciaire n’est pas le temps médiatique ».
C’est au bénéfice de ces quelques observations que j’ai l’honneur de requérir qu’il vous plaise, Monsieur le Premier Président de :
– Faire donner lecture par Monsieur le Greffier en Chef des dispositions des articles 32 et 33 de la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
– Déclarer l’année judiciaire 2015 close et l’année judiciaire 2016 ouverte ;
– Me donner acte de mes réquisitions ;
– Dire que du tout il sera dressé procès-verbal pour être classé au rang des minutes du Greffe de la Haute Cour.




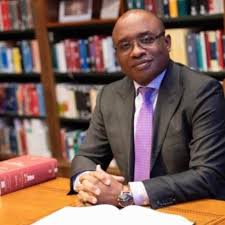




Il s’agit d’un discours sur un vieux problème. Les lenteurs judiciaires nous exaspèrent parfois au pays. Si pour le Procureur Luc Djodo, le juge devrait prendre un temps de recul, moi je pense que ce temps doit faire l’objet d’une loi.