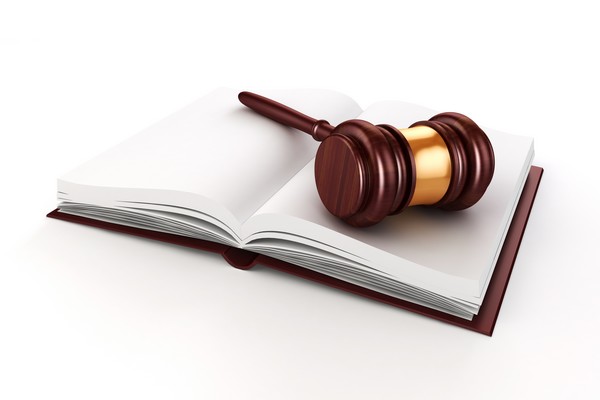Mots clés
Régime matrimonial – Coutume Bamiléké – Condition d’existence de la communauté de biens – Nécessité d’une contribution non équivoque de la femme à l’acquisition des biens communs (Oui) – Sanction – Cassation
Observations
…
En droit écrit, il existe des règles précises qui permettent de déterminer le régime matrimonial des époux, issues et contenues à l’article 1400 et suivants du Code Civil. Elles se résument en une alternative des plus simples : s’il existe un contrat de mariage valable, c’est le régime matrimonial choisi dans ce contrat de mariage par les futurs époux qui sera le leur ; s’il n’en existe pas, ou si même établi il s’avère néanmoins nul car irrégulier, le régime matrimonial des époux sera le régime légal. Ce dernier est le régime fixé par la loi à défaut de volonté exprimé – justement dans un contrat de mariage – des époux : c’est le régime de la communauté des meubles et acquêts.
En droit coutumier, il y’a une absence très nette de règlementation. Même l’ordonnance du 29 juin 1981 (J.O.R.U.C ? 1er Août 1981, n°14, p.1639) n’en parle guère (elle crée une confusion entre système matrimonial – ou formes du mariage – et régime matrimonial). La jurisprudence dû donc y suppléer ; il est d’ailleurs patent que la quasi-totalité des arrêts rendus par la Cour Suprême et touchant à la détermination du régime matrimonial sont rendus en matière coutumière, c’est-à-dire si le problème s’y pose avec acuité.
C’est pourquoi le droit coutumier des régimes matrimoniaux est un droit essentiellement jurisprudentiel, encore qu’il faille préciser la portée de ce dernier mot. Non pas que la jurisprudence crée la coutume en la matière, mais elle la constate, celle – originelle, évoluée – énoncée par les justiciables devant le juge de fond qui la reçoit. Elle est donc l’assise, le simple support des règles juridiques d’origine coutumière, et ainsi de la source du Droit qu’est la coutume, aussi bien que, et comparativement, le texte de la loi est le support des règles juridiques écrites.
Il est donc important de scruter la jurisprudence pour savoir ce qu’est le régime matrimonial en droit coutumier car, la doctrine, si elle ne fut pas en reste, n’a pas été d’un apport décisif en la matière.
Dans l’affaire Kamgang, le juge d’appel décida de ce qu’il avait existé entre lui et sa femme, dame Mouaha K.B., une « communauté des biens », ordonna en conséquence le partage par moitié de celle-ci et commis un greffier-notaire pour effectuer cette opération. Il tirait, pour ce faire, argument de la règle coutumière bamiléké énoncée en l’espèce et selon laquelle « il y’a communauté des biens lorsque la femme a contribué de manière non équivoque à l’enrichissement du mari ». M. KAMGANG, n’acceptant pas une telle solution, se pourvut en cassation.
Ses prétentions étaient doubles. D’une part, il reprochait concrètement à la décision du juge d’appel, bien qu’ayant ordonné le partage, d’avoir omis d’apprécier la consistance de la communauté – en ses biens meubles – et de n’y avoir pas procédé par lui-même, le greffier-notaire commis n’ayant aucune compétence pour le faire ; sa décision violait ainsi la loi – laquelle ? Cela n’est guère précisé ! -, ou à tout le moins, manquant de base légale. Le juge suprême était donc saisi donc saisi de la question de savoir quel était le rôle du notaire, dans le cadre de la liquidation et du partage d’une communauté, fut-elle prétendue ?
Il est curieux que la Cour Suprême n’ait pas répondu précisément à cet aspect du moyen, préférant mettre l’accent sur un autre (plus pertinent ?). Toujours est-il que la solution, en cette matière, est désormais connue (le notaire ou l’expert qui en fait office, sur l’ordre et le contrôle du juge procède à la liquidation des biens, le juge, quant à lui, procède à leur attribution ou répartition, bref au partage.)
D’autre part, il semble qu’il est reproché – mais cela n’apparaît vraiment pas clairement de l’arrêt de la Cour Suprême – au juge d’appel, non pas tant de ne pas avoir énoncé la coutume Bamiléké applicable relativement à l’existence du régime matrimonial – ce qu’il avait clairement fait -, mais de ne pas l’avoir fait en ce qui concerne les modalités du partage des biens de ce régime ; sa décision violait ainsi les dispositions de l’art. 18 du décret du 19 décembre 1969. La règle coutumière Bamiléké présidant au partage à égalité avait-elle été ? la réponse négative s’imposait à la Cour, d’où la cassation de l’arrêt d’appel.
Et, au surplus, ajoutait la Cour Suprême, cette fois-ci d’elle-même, la coutume Bamiléké relative à la nature du régime matrimonial des époux n’avait également pas été respectée. Elle supposait que la femme fasse la preuve de sa contribution à l’acquisition des biens communs ; or le juge d’appel, constatant que la femme ne « prétendait » qu’avoir exercé la profession de couturière – de laquelle, par les revenus induits, aurait été présumée sa participation -, une fois de plus, sa décision. Sa décision méritait d’autant la cassation.
Ce faisant la Cour Suprême valide implicitement la coutume Bamiléké telle qu’énoncée, celle selon laquelle il existe une communauté de biens entre époux, à condition que la femme ait contribué, c’est-à-dire participé, à l’enrichissement du mari, entendons de la communauté (il s’agit sans doute d’une coutume évoluée ; et cela se comprendrait d’autant par l’illusion – la confusion – opérée entre les biens de la communauté et ceux du mari, car les coutumes originelles semblaient faire du mari le seul propriétaire des « biens communs »
La suite de cette observation rédigée par Le professeur Guy Blaise Dzeukou est disponible dans l’ouvrage intitulé « LES GRANDES DECISIONS DE LA JURISPRUDENCE CIVILE CAMEROUNAISE » Sous la direction de M. François ANOUKAHA, agrégé des facultés de droit.