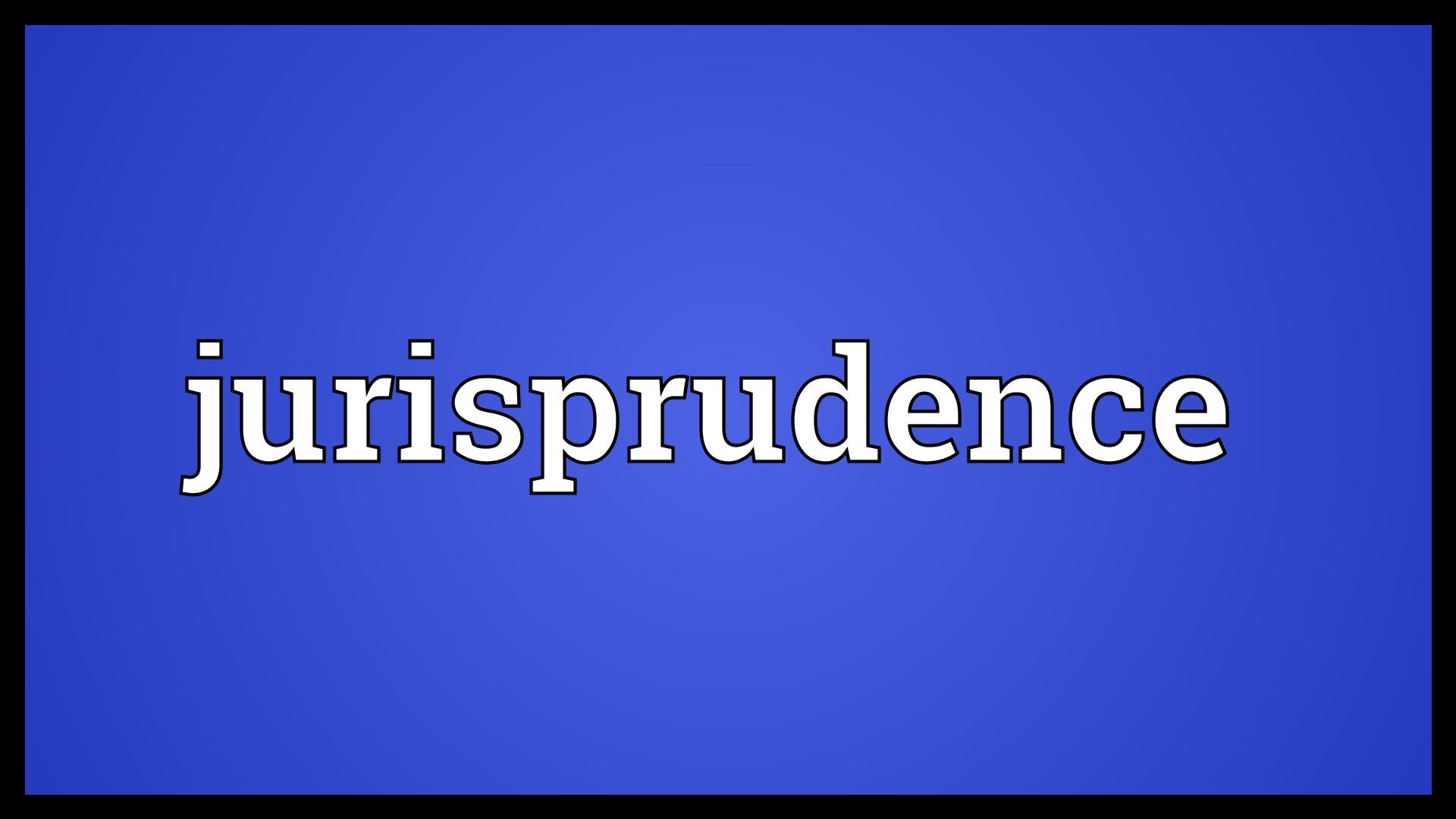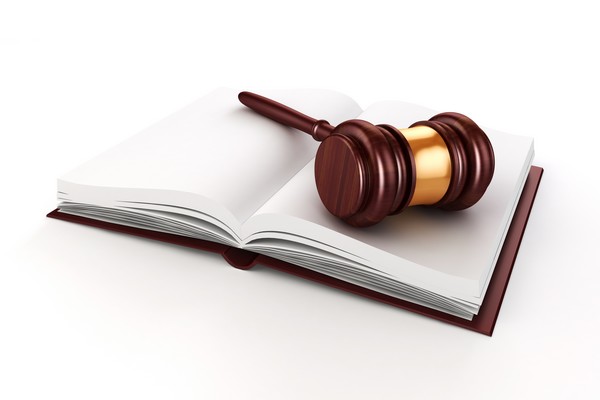Mots clés
Commentaires
Ce commentaire a été publié pour la première fois dans la revue ERSUMA et à ersuma.com
ARRET N° 001/CJ/CEMAC/CJ/10-11 DU 25 NOVEMBRE 2010. AFFAIRE ECOLE INTER-ETATS DES DOUANES C/ DJEUKAM MICHEL LA CJ-CEMAC A RENDU SON PREMIER ARRET PREJUDICIEL
Une mauvaise application du droit communautaire par le juge centrafricain a abouti au premier arrêt préjudiciel rendu par la CJ-CEMAC, ce après dix ans de fonctionnement effectif. Grand acquis du droit communautaire général, le recours préjudiciel est le mode de coopération judiciaire privilégié entre le juge national et le juge communautaire en vue d’une application harmonisée du droit communautaire sur l’ensemble des Etats membres. Fondé dans la CEMAC sur l’article 17 de la Convention régissant la Cour de justice de la Communauté, ce recours donne la possibilité au juge national de solliciter l’interprétation ou l’appréciation de légalité d’un acte communautaire en cause dans une procédure nationale. Certes, le juge centrafricain qui sollicita le juge communautaire dans l’affaire DJEUKAM ne pécha pas quant à l’esprit de cet instrument de coopération. Tout le reproche qui peut lui être adressé touche à la méconnaissance totale des règles fondamentales de répartitions des compétences entre le juge communautaire et lui-même, juge national.
Les faits de l’espèce sont de compréhension aisée ; ce qui l’est moins, est qu’ils n’aient pas pour autant donné lieu à quelques interrogations de base quant au juge habilité à donner réponse aux questions de droit qu’ils ont suscitées. Monsieur DJEUKAM occupait les fonctions de professeur vacataire dans une institution communautaire, l’Ecole Inter-Etats des douanes (EIED) dont le siège se trouve à Bangui en République Centrafricaine. Par une décision n° 23 du 30 avril 2004, il fut promu Chef de département Culture générale, pour se voir par la suite révoqué par une autre Décision datée du 30 avril 2006. Peu d’éléments de l’arrêt permettent d’apprécier les circonstances de cette rétrogradation ; cependant, elle donna lieu à une saisine du Tribunal de travail de Bangui. Le sieur DJEUKAM sollicitait des d’indemnités de fonction et des dommages et intérêts. Devant cette instance, il obtint gain de cause contre L’IEID qui attaqua le jugement rendu auprès de la Cour d’appel de Bangui, Chambre sociale.
C’est alors que cette dernière juridiction, plus préoccupée que la première par les éléments d’extranéité présents dans le dossier, focalisa son appréciation des faits de la cause sur la légalité de la décision n° 23 du 30 avril 2004 portant nomination du Sieur DJEUKAM aux fonctions de Chef de Département Culture générale. On ne saura jamais quels furent ses éléments de référence. On peut penser que la question de légalité qui devint ainsi prégnante pour elle était en lien avec quelque autre texte communautaire puisque, par une décision avant-dire-droit du 11 juin 2009, elle se tourna vers la CJ-CEMAC, jugeant « (…) qu’il y a lieu de surseoir à statuer en attendant « l’avis » de la Cour de Justice de la CEMAC, en application de l’article 17 de la Convention régissant ladite Cour ». Sans aucun doute, quant à la procédure, il s’agissait effectivement d’une demande préjudicielle, qui rentre ainsi dans la jurisprudence de la Cour comme la première que reçut la CJ-CEMAC.
Quant au fond, cette demande ne put donner lieu à un premier arrêt préjudiciel digne. La fin de non-recevoir que solde finalement l’arrêt s’impose, le juge centrafricain n’ayant pas motivé sa question préjudicielle en indiquant en quoi la décision n° 23 lui semblait illégale. Cependant, ab initio, toute la procédure semblait compromise au regard de sensibles entorses aux règles de répartitions de compétence dont fit preuve les juridictions centrafricaines qui intervinrent dans la cause. En effet, fonctionnaire communautaire, le Sieur DJEUKAM n’aurait jamais pu être reçu par une juridiction nationale dans le cadre d’une demande touchant aux règles de la fonction publique communautaire, en application des articles 4 in fine et 20 de la Convention régissant la CJ-CEMAC. Il s’agit là d’une compétence exclusive du juge communautaire. Cette élémentaire question de compétence fut ignorée autant par les conseils que par les deux juges centrafricains qui connurent de l’affaire, d’abord le Tribunal du travail, en première instance, ensuite la Chambre sociale, en appel. Le juge communautaire s’astreignit alors à un rappel du point du droit communautaire ainsi mis à mal. Dès lors, les apports de l’arrêt préjudiciel DJEUKAM furent totalement détournés.
Le bien et le mal semblent fatalement liés dans une sorte de destinées croisées. En effet, l’affaire DJEUKAM, engagée sur une mauvaise saisine au niveau national, permit au juge communautaire d’édifier l’ensemble des juges de la sous-région et les praticiens, en tête desquels les conseils, sur le régime du recours préjudiciel. Il constituait jusqu’à la date du 25 novembre 2010 un mécanisme juridictionnel purement théorique, régulièrement et prioritairement enseigné dans les nombreux séminaires de vulgarisation organisés par la CJ-CEMAC. Cette théorie du recours préjudiciel invite à distinguer le recours préjudiciel en appréciation de légalité du recours préjudiciel en interprétation, au sens de l’article 17 précité de la Convention régissant la CJ-CEMAC. Le premier permet au juge communautaire d’apprécier la conformité d’un texte ou une pratique communautaire dérivé(e) au regard de l’ensemble du dispositif normatif communautaire supérieure et le second invite le juge communautaire à donner le sens exact d’un texte de droit communautaire. Certes, des erreurs terminologiques caractérisaient déjà la rédaction de l’arrêt-avant-dire droit par lequel le juge de Bangui saisît le juge de la CJ-CEMAC à titre préjudiciel. Cependant, il paraissait incontestable qu’il invitait le juge communautaire à une appréciation de légalité : « la Cour d’Appel de Bangui (Chambre sociale) a estimé que la légalité de la décision administrative n°23/CEMAC/EIED du 30 Avril 2004 du Directeur de l’Ecole Inter – Etats des Douanes de la CEMAC portant nomination des chefs de départements est mise en cause, et qu’il y a lieu de surseoir à statuer en attendant « l’avis » de la Cour de Justice de la CEMAC, en application de l’article 17 de la Convention régissant ladite Cour » . En effet, dans l’arrêt préjudiciel en appréciation de légalité – comme d’ailleurs dans tout arrêt préjudiciel – le juge ne donne pas un avis, il « dit le droit ». Cet épigraphe du dispositif des arrêts préjudiciels contient à lui tout seul toute la portée et les attentes placées en ce recours : « le juge dit pour droit… ».
Somme toute, les leçons à tirer de ce premier arrêt préjudiciel restent déterminantes au regard de la connaissance du droit communautaire naissant en Afrique Centrale, au demeurant sur un double aspect. D’abord relativement à ce recours : le respect des conditions de recevabilité d’un recours préjudiciel en appréciation de validité reste liminaire. Cependant, le recours préjudiciel est un dialogue de juge à juge (I), la motivation de l’illégalité en question reste déterminante quant au succès du recours. Ensuite, au regard des règles de répartition des compétences entre le juge national et le juge communautaire : le contentieux de la fonction publique communautaire constitue une compétence exclusive du second juge (II).
- LE RECOURS PREJUDICIEL, UN DIALOGUE DE JUGE A JUGE
L’expression de Madame NAOME fut fort opportunément exploitée par le juge Ndjamena pour (r)enseigner sur la nature « dialogique » du recours préjudiciel. Ceci implique que le motif de l’illégalité invoqué par le juge qui ouvre le dialogue doit être précisé (B), condition déterminante, sous peine de rejet de la demande. Cette règle est sans préjudice de l’appréciation préliminaire par le juge de N’djamena des règles régissant la recevabilité d’un recours préjudiciel (A).
- DES CONDITIONS PRELIMINAIRES : LES REGLES DE RECEVABILITE DU RECOURS PREJUDICIEL
L’engagement du dialogue préjudiciel en droit communautaire CEMAC suppose que les conditions de recevabilité d’une demande de cette nature soient respectées. Les textes communautaires restent peu précis sur ce point. Mais la jurisprudence n’est-elle pas une source du droit ? Avec l’arrêt du 25 novembre 2010, Le juge de N’djamena a offert une grande lisibilité aux conditions de recevabilité d’une demande préjudicielle en appréciation de validité : la nature de l’acte susceptible d’une telle appréciation est déterminante à cet égard (1). De ce fait, il s’impose au juge communautaire, pour achever sa logique didactique, d’indiquer les actes exclus (2).
- Les conditions relatives à la nature de l’acte susceptible d’une appréciation préjudicielle en légalité
Le juge s’est imposé, au cours de l’analyse des conditions de recevabilité du recours préjudiciel présenté par la Cour d’appel de Bangui, de vérifier que la décision n° 23 soumise à son contrôle relevait de la catégorie des actes susceptibles d’une appréciation préjudicielle en légalité. En effet, la diversité des actes communautaires est une réalité. La théorie générale du droit communautaire invite à distinguer les actes de droit primaire des actes de droit dérivé . Cette catégorisation contient une hiérarchisation desdits actes. Partisan d’une application régulière de cette théorie, le juge communautaire rappelle que seuls les actes communautaires dérivés sont susceptibles d’une appréciation de légalité. Aussi faudrait-il que le juge national qui entend saisir le juge communautaire en appréciation de légalité, s’assure en premier, que l’acte en cause est un acte communautaire (a) et en second, qu’il s’agit d’un acte communautaire dérivé (b). a. Un acte communautaire
Dans le cadre de cette étude limitée, la définition de l’acte communautaire peut être simplifiée, bien que, comme « acte juridique », il recouvre une réalité que la doctrine internationaliste situe au cœur d’une controverse : il s’agit d’un acte juridique appartenant à l’ordre juridique communautaire. La nature de ces actes est précisée aux articles 40 et suivants du Traité révisé de la CEMAC. La nomenclature des actes communautaires est variée : « unité terminologique et diversité typologique », synthétise la doctrine. De fait, cet article nomme, par ordre hiérarchique, le Traité, l’Additif, les Conventions, les Actes additionnels, les Règlements, les Règlements-cadre, les Directives, les Décisions, les Recommandations et les Avis. Mais, cette liste de l’article 40 précité n’est pas exhaustive. Les règlements intérieurs des institutions communautaires doivent également y figurer, tout comme les différents accords que peut conclure la Communauté au titre de ses relations internationales, en application notamment de l’article 36 de l’additif relatif au système institutionnel et juridique de la CEMAC .
Par ailleurs, il existe une catégorie d’actes dits innommés, procédant de l’activité administrative des institutions communautaires. Ils ont, pour certains, bénéficié d’une qualification du juge communautaire : par exemple, un protocole d’accord adopté par la COBAC, un avis conforme donné dans le cadre d’une procédure bancaire, la résolution du conseil d’administration d’une institution communautaire comme la BDEAC constitue un acte communautaire. Ce système normatif survit globalement aux réformes institutionnelles engagées en 2005. Il faudrait par conséquent, dans cette grande famille normative, circonscrire ceux qui sont affiliés au droit communautaire dérivé, seuls susceptibles du recours préjudiciel en appréciation de légalité.
- Un acte communautaire dérivé
L’appréciation de légalité dans le cadre d’un recours préjudiciel ne peut s’exercer que sur les actes de droit communautaire dérivé. Cette catégorie d’actes est ainsi désignée par les théoriciens du droit communautaire eu égard du fait qu’ils sont générés en vue de l’application des actes de droit primaire, ceux qui fondent la Communauté. A partir de cet élément de rattachement, l’identification des actes de droit dérivé peut procéder d’une approche simple consistant à les distinguer matériellement des actes fondateurs . L’acte fondateur par excellence est le Traité : il s’agit de l’acte de naissance de la Communauté. Mais d’autres actes lui sont expressément rattachés par le législateur communautaire, leur conférant naturellement la qualité d’acte fondateur : ce bloc institutif est évoqué par le législateur par l’expression « Traité de la C.E.M.A.C. et des Textes subséquents » . Il s’agit : de l’Additif, des Conventions, qui relèvent de la compétence des Etats membres et des Actes additionnels, attribués à la Conférence des chefs d’Etat de la CEMAC.
En conséquence, il faudrait considérer que tous les autres actes communautaires, à l’exclusion des actes de droit communautaire primaire ci-haut isolés, constituent des actes de droit dérivé. Ceci renvoie, suivant la typologie des actes communautaires inventoriés, et rappelée dans une didactique louable par le juge communautaire dans son arrêt du 25 novembre 2010 : aux règlements, règlements-cadre, directives, décisions, avis, recommandations et tous les autres actes innommés. Les trois premiers émanent des deux Unions : l’Union Economique et l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale, cadres d’élaboration des politiques communautaires. Les autres peuvent être adoptés par les premiers responsables des Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté, selon le système institutionnel privilégié par la CEMAC (V. Infra). C’est donc à bon droit que la décision n° 23 du Directeur de l’IEID dans l’affaire DJEUKAM a pu bénéficier de toute l’attention du juge, dans le cadre de l’appréciation de légalité, dans la mesure où il n’appartenait pas à la catégorie des actes exclus d’un tel contrôle.
- Les actes exclus de l’appréciation de légalité
La limitation faite à partir des actes communautaires de droit dérivé comme seuls susceptibles d’une appréciation de légalité conduit à considérer comme exclus d’une telle appréciation trois catégories d’actes : les actes de droit communautaire primaire en premier, mais aussi, les actes normatifs émanant des Etas membres et les actes relevant d’autres systèmes juridiques internationaux.
- Les actes de droit communautaire primaire
La première catégorie des actes insusceptibles d’un recours préjudiciel en appréciation de légalité appartient naturellement au système normatif communautaire lui-même : ce sont les actes de droit communautaire primaire. Il s’agit : du Traité, et par la force de la loi communautaire elle-même (V. infra), de l’Additif, des Conventions et des Actes additionnels. La rédaction même de l’article 17 de la Convention régissant la CJ-CEMAC donne à comprendre que ces actes communautaires sont susceptibles uniquement d’une appréciation préjudicielle en interprétation, dans la mesure où ils ne figurent plus dans la portion de phrase indiquant les actes susceptibles d’une appréciation en légalité : « La Chambre Judiciaire statue à titre préjudiciel sur l’interprétation du Traité de la C.E.M.A.C. et des Textes subséquents, sur la légalité et l’interprétation des Statuts et des Actes des Organes de la C.E.M.A.C., quand une juridiction nationale ou un organisme à fonction juridictionnelle est appelé à en connaître à l’occasion d’un litige ».
Cette lecture légaliste ne saurait conduire à ignorer le débat suscité par l’Acte additionnel . Une utilisation tout azimut de cet Acte par la Conférence des chefs d’Etats a abouti finalement à sa fragilisation. D’une vocation règlementaire naturelle, lui permettant de « compléter le traité sans le modifier » , l’Acte additionnel a souvent servi, comme une décision, à adopter des mesures individuelles, servant notamment à nommer les premiers responsables communautaires. Cela a justifié la thèse de la justiciabilité de cet acte en général , et notamment, son contrôle de légalité dans le cadre du recours préjudiciel.
Cette réserve étant émise, on peut, pour conclure, soutenir que l’exclusion des actes fondateurs du champ du renvoi préjudiciel en appréciation de légalité relève d’une logique juridique compréhensible. On ne saurait envisager une appréciation de légalité portant sur un texte fondateur, qui constitue la référence dernière d’une telle appréciation, socle de la Communauté de droit en cours de construction. Dans l’appréciation préjudicielle, l’acte communautaire de droit dérivé sera jugé légal ou illégal en référence à tel autre acte communautaire, dérivé ou primaire, mais tous les actes dérivés doivent leur légalité à leur conformité aux textes fondateurs de la Communauté. Toute demande d’appréciation de légalité de ces actes fondateurs encourrait indubitablement l’irrecevabilité, tout comme celle portant sur un acte normatif émanant non pas d’une institution communautaire, mais d’un des Etats membres.
- Les actes émanant des Etas membres
L’appréciation de légalité des actes nationaux est envisageable devant le juge communautaire ; cependant, elle ne saurait être réalisée dans le cadre d’un recours préjudiciel, au sens de la limitation précise contenue dans l’article 17 précité. Du fait que le juge communautaire ne dispose que d’une compétence d’attribution, le prisme de définition de ces compétences est fonction des objectifs d’harmonisation du droit communautaire. L’appréciation préjudicielle en constitue l’instrument privilégié : il porte exclusivement sur les actes émanant de la Communauté. Il semble donc conséquent que les actes des Etats membres soient exclus d’une telle procédure . Il s’agit de tous les actes, normatifs, règlementaires, décisionnels, créateurs ou non d’effets juridiques.
Cependant, les Etats membres disposent d’un pouvoir législatif, exécutif et judiciaire autonomes, marque de leur souveraineté ; leurs actes peuvent s’avérer contraires à quelque disposition communautaire. Aussi, le système communautaire a instauré la voie indirecte de l’exception d’illégalité pour rendre possible l’appréciation juridictionnelle des actes émanant des Etats : « Toute partie peut, à l’occasion d’un litige, soulever l’exception d’illégalité d’un Acte juridique d’un Etat membre ou d’un Organe de la CEMAC » . Exception de défense, elle ne peut jouer que dans le cadre d’une action fondée sur un acte communautaire (annulation ou responsabilité : V. infra). Pour illustrer, l’affaire AMITY BANK a permis au juge communautaire d’apprécier le moyen de défense tiré de l’exception d’illégalité de l’ordonnance camerounaise n° 96/03 du 24 Juillet 1996 relative à la restructuration des Établissements de crédit au Cameroun et de l’arrêté n° 00000483/MINFI du 19 Septembre 2008 portant restructuration de AMITY BANK CAMEROON PLC . Une telle possibilité est difficilement envisageable en ce qui concerne les actes issus d’autres systèmes juridiques, d’office hors du champ de compétence du juge de la CEMAC.
- Les actes relevant d’autres systèmes juridiques internationaux
En principe, le juge de N’djamena n’est pas compétent pour connaître à titre préjudiciel des recours en appréciation des actes émanant d’autres systèmes juridiques internationaux, suivant la limitation expresse contenue dans le texte de l’article 17 de la Convention régissant la CJ-CEMAC : « La Chambre Judiciaire statue à titre préjudiciel (…) sur la légalité et l’interprétation des Statuts et des Actes des Organes de la CEMAC, quand une juridiction nationale ou un organisme à fonction juridictionnelle est appelé à en connaître à l’occasion d’un litige ». Cette exclusion est loin d’être en phase avec la volonté affirmée d’une application harmonieuse du droit communautaire CEMAC dans les Etats membres, lorsqu’on confronte cet objectif avec la multiplication ces dernières années des systèmes d’intégration à vocation voisine. Les Etats membres de la CEMAC sont impliqués chacune dans au moins deux autres systèmes d’intégration présent dont le champ matériel, touchant ici au droit économique, et là au droit des affaires, sont appelés à se rencontrer. Spécialement, ils sont tous membres de l’OHADA et de la CEEAC . Les interférences entre leurs objectifs constituent aujourd’hui une grande source de préoccupation dans les plus hautes instances. Des hypothèses de non-conformité au droit de la CEMAC ne seraient pas pures hypothèses d’école. Mais elles semblent difficiles à envisager dans le cadre d’une demande préjudicielle. Il est clair qu’aucune juridiction de l’un des Etats membres de la CEMAC ne saurait raisonnablement soumettre à la CJ-CEMAC une demande préjudicielle portant sur un acte adopté dans le système juridique de l’OHADA. Tout danger n’est pas pour autant définitivement écarté.
Dans le cadre du contentieux direct comme dans sa fonction consultative, le juge de N’djamena a souvent été invité à se prononcer sur des actes émanant de l’OHADA, directement ou indirectement. En cause, des interférences entre le droit des sociétés commerciales, ou le droit des procédures collectives, régis par l’OHADA et dont le contentieux doit être soumis, en cassation, à la CCJA, et le droit bancaire de l’Union monétaire de l’Afrique Centrale dont le contentieux relève de la compétence de la CJ-CEMAC . Concernant la CJ-CEMAC, une première entorse aux règles de compétence avait été commise aux premiers abords de sa fonction consultative. En 2003, le Gouverneur de la BEAC avait sollicité la CJ-CEMAC dans le cadre du processus normatif en vue de l’adoption de l’avant-projet de règlement CEMAC relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement . Appelé à donner son avis, entre autres, sur la compatibilité de l’avant-projet avec les autres dispositions de la législation de l’OHADA, la Cour, par une motivation consternante, cautionna l’idée d’une subordination du droit CEMAC au droit OHADA pour mettre en exergue l’utilité d’une telle appréciation de compatibilité. Cette motivation est la suivante : « Considérant que selon l’article 10 du Traité institutif de l’OHADA en effet, « les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieure ou postérieure », que cette disposition supranationale a une valeur contraignante pour les Etats concernés et s’applique aux normes primaires et dérivées issues du Traité de la CEMAC (…) » . La Cour venait ainsi de mettre sa mission à rude épreuve : compromettre la primauté du droit communautaire plutôt que la protéger. En se prononçant sur le droit OHADA comme elle le fit abondamment dans cet avis, la Cour était sortie de son champ de compétence matérielle, alors qu’il lui suffisait de respecter la délimitation précise contenue dans l’article 6 de la Convention régissant la Cour. Cette position purement consultative est aujourd’hui heureusement annihilée par une réelle orthodoxie jurisprudentielle tracée dès la même année 2003 dans le cadre de l’affaire TASHA. Aujourd’hui, sa jurisprudence est constante chaque fois qu’il s’agit de se prononcer sur le droit de l’OHADA : « Considérant que le contentieux relatif à l’application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions nationales, et en cassation par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Selon les dispositions des articles 13 et 14 du Traité de l’OHADA, Qu’en conséquence, la Cour est incompétente pour connaître des moyens tirés de l’inobservation des dispositions du droit OHADA » . Dans le contentieux direct comme dans la procédure indirecte du recours préjudiciel, il y a donc lieu de conclure que les actes relevant de l’OHADA ne font pas partie des actes recevables par le juge de la CEMAC .
En définitive, le recours préjudiciel en appréciation de légalité tient son succès de l’observation des conditions de recevabilité tenant à la nature de l’acte en cause, qui doit être un acte communautaire. Cependant, il revient au juge national qui invite le juge communautaire au dialogue, d’en donner les axes, en motivant l’illégalité problématique.
- UNE CONDITION DETERMINANTE : L’OBLIGATION DE MOTIVATION DE LA SUSPISCION D’ILLEGALITE
L’arrêt DJEUKAM est venu pallier la réglementation insuffisante actuelle de la saisine préjudicielle. Celle qui est contenue dans l’article 13 de l’Acte additionnel portant règles de procédure devant la Chambre judiciaire de la CJ-CEMAC est particulièrement vide quant au fond de la requête préjudicielle. Suite à l’arrêt DJEUKAM, tout juge national saura désormais qu’il ne suffit pas d’énoncer une suspicion d’illégalité (1), il s’avère déterminant de motiver celle-ci (2).
- L’énoncé de l’illégalité suspectée
La question préjudicielle en appréciation de légalité consiste à soumettre au juge communautaire une question relative à la conformité d’un texte communautaire au droit du même système. Il y a donc, à la base d’une question préjudicielle en appréciation de légalité, un doute quant à la légalité de l’acte objet du renvoi. Sur ce point, le juge communautaire a marqué cet arrêt préjudiciel de principe d’une grande lacune : il n’y a donné aucune indication permettant, selon ses attentes, de caractériser la suspicion d’illégalité. L’analyse comparée avec le droit du contentieux européen donne à apprécier un facteur-clé au cœur du déclenchement de la procédure préjudicielle en appréciation de validité : le facteur du doute. Ce doute s’apprécie différemment selon qu’il s’agit d’un recours préjudiciel en appréciation de validité, comme c’était le cas en l’espèce, ou d’un recours préjudiciel en interprétation , seconde branche de ce mode de coopération juridictionnelle entre le juge national et le juge communautaire.
Le doute dans la demande préjudicielle en appréciation de légalité n’a fait l’objet d’aucune systématisation en matière communautaire, certainement dans la mesure où il se construit sur la résurgence au niveau communautaire d’une mission dévolue au juge administratif national : le recours pour excès de pouvoir. Ce recours permet au juge administratif de sanctionner la conformité d’un texte au regard d’un autre relevant du même ordre juridique. Comme le révèle la pratique éculée du contentieux administratif interne, cette légalité s’entend soit de la légalité interne, soit de la légalité externe. La légalité interne renvoie au respect des règles de fond régissant le contenu d’un texte communautaire. Cette erreur est caractérisée par l’erreur de droit (application d’un texte en lieu et place d’un autre) ou l’erreur de fait, notamment lorsqu’ils sont inexacts (erreur manifeste d’appréciation). On y inclut également le détournement de pouvoir, qui caractérise la situation dans laquelle l’administration a pris un acte dans un but différent de celui qui est prévu par les textes.
La légalité externe quant à elle renvoie au respect des conditions de forme et de procédure régissant un acte communautaire. L’illégalité excipée dans ce cadre touche : l’auteur de l’acte, qui pourrait être incompétent , toutes les formes d’irrégularité procédurale, par exemple dans la mise en œuvre du contradictoire ou la non consultation d’instances idoines avant la prise d’une décision. Il faut aussi y adjoindre toutes les défaillances liées au formalisme, à l’instar de l’absence de motivation d’une décision.
Aucune de ces formes d’illégalité n’avait fait l’objet d’aucun commencement de qualification dans l’affaire DJEUKAM, ce qui justifia la fin de non-recevoir opposée par le juge de N’djamena. Il convenait, une fois identifiée le point d’illégalité suspectée, qu’il fût énoncé avec clarté. Ensuite, le juge de renvoi aurait dû s’atteler certes à justifier sa décision de renvoi, mais surtout à expliquer au juge communautaire les raisons qui suscitent ses interrogations, à savoir, motiver l’illégalité suspectée.
- La motivation de l’illégalité suspectée
La motivation de l’illégalité d’un texte communautaire soumis à l’appréciation du juge communautaire invite le juge national à indiquer de manière claire et précise les éléments de fait et de droit sur la base desquels la violation de la règle de droit communautaire est soupçonnée. La motivation peut être indexée sur un texte de droit communautaire primaire, ou un texte de droit dérivé. La motivation doit permettre de justifier le renvoi préjudiciel ; cependant, il a pour rôle ultime de donner au juge communautaire les moyens d’exercer utilement son contrôle : « la Cour d’Appel de Bangui qui ne dit pas en quoi la légalité de la décision n°23/CEMAC/EIED concernée est contestée, ne met pas la Cour en l’état d’apprécier la validité de cette décision » . Dans le contexte du renvoi préjudiciel en appréciation de validité, l’obligation de motivation invite le juge national à une première analyse empirique entre deux textes, dont l’un, texte communautaire, présenterait une illégalité au regard d’un autre, de même source, hiérarchiquement supérieur. Il s’agit donc prosaïquement d’une analyse comparative, idéalement suscitée et nourrie par la défense. Cette analyse comparative tient lieu de motivation , qui est d’abord une démonstration juridique : le juge communautaire peut sur cette base valablement exercer son contrôle de validité. Il se fonde, dès lors, sur les éléments certes de fait entourant la cause, mais surtout de droit. Il s’agit, en l’occurrence, des textes mis en comparaison dans la motivation par le juge national, qui reçoit, par la suite, une appréciation du juge communautaire, comme spécialiste. C’est ce principe et ce séquençage des échanges entre les deux juges de la procédure préjudicielle qui permet de soutenir que « le contentieux préjudiciel [est] l’archétype d’une justice dialogique ».
En l’espèce, et c’est en cela également que le recours préjudiciel de l’affaire NJEUKAM avait peu de chances de prospérer, la Cour d’appel de Bangui se contentait d’éprouver « des doutes sur la validité de la décision n° 23/CEMAC/EIED du 30 avril 2004 portant nomination des chefs de département », sans dire au juge communautaire en quoi cette validité était douteuse. Il s’impose donc de reconnaître, sur ce point, que le juge communautaire a fait une application correcte du droit processuel communautaire. Toutefois, il est possible, notamment en prenant appui sur le droit comparé, de s’interroger sur le point de savoir s’il aurait pu en faire une application efficace, afin que la sanction de la fin de non-recevoir finalement prononcée soit évitée. En effet, cette fausse réponse ne participe pas à entretenir l’esprit d’interactivité qui innerve la coopération juridictionnelle que le recours préjudiciel constitue. La fin de non-recevoir a mis un terme au « dialogue » alors qu’une vraie réponse de droit n’avait pas été donnée à la question posée par le juge national. Cette question reste le nœud gordien qui étrangle la procédure nationale ; la sollicitation préjudicielle a vocation à donner au juge communautaire, seul habilité à le faire, l’opportunité de le dénouer. Dans l’affaire DJEUKAM, le juge communautaire aurait-il pu mieux appliquer le droit afin que le juge de Bangui tranche à son tour l’affaire qui l’a conduite devant la Cour de justice de Ndjamena ? Il faudrait, pour y répondre, trouver des alternatives de solutions qui aboutissent à un dialogue fructueux entre les deux juges, et non à sa rupture, même justifiée .
En effet, une jurisprudence tendant à accentuer le sens d’ « une collaboration aussi fructueuse que possible » dans laquelle est inscrit le recours préjudiciel a conduit le juge communautaire européen à sanctionner moins durement les défaillances des juridictions nationales européennes à l’obligation de motivation. Dans un arrêt préjudiciel rendu le 7 juillet 1981, il a soulevé d’office des moyens d’invalidité non présentés par le juge national de renvoi ; dans un autre, il a requalifié une demande préjudicielle en interprétation en une demande en appréciation de validité , au regard certes de la formulation de la décision de saisine. Par ailleurs, grâce à une réforme de son règlement de procédure, le juge communautaire européen dispose désormais du droit de solliciter des éclaircissements du juge de renvoi . Aussi, des approches plus efficaces peuvent-elles être privilégiées. Les exemples européens démontrent que les prérogatives du juge communautaire sont larges, et que, le juge de la CEMAC aurait pu, par exemple par lettre administrative relevant des prérogatives du juge rapporteur , répondre au dialogue en invitant le juge de Bangui à corriger le déficit de l’acte de saisine, afin que cette interactivité débouche sur une réelle réponse préjudicielle, en cette phase embryonnaire où la nécessité est grande de combler les lacunes législatives de l’aménagement de ce recours.
A la décharge du juge de la CJ-CEMAC en l’espèce, il faut convenir que les circonstances de l’affaire DJEUKAM rendaient nulle toute chance de redressement procédural en vue d’améliorer son rendement jurisprudentiel. Toute la procédure apparaissait fortement compromise ab initio, les règles de saisine n’ayant pas été respectées sur le point déterminant du juge compétent pour connaître du litige en cause : le sieur DJEUKAM, fonctionnaire communautaire, revendiquait des droits tirés de sa rétrogradation. Il s’agissait à n’en point douter, d’un contentieux de la fonction publique communautaire, qui n’aurait jamais dû se trouver entre les mains d’un juge national.
- LE CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE, UNE COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE COMMUNAUTAIRE
L’arrêt DJEUKAM n’aurait jamais dû compter au rang des arrêts préjudiciels ; en droit, sa phase nationale n’aurait jamais dû avoir lieu. En effet, était en cause dans ce premier arrêt préjudiciel un fonctionnaire communautaire sollicitant l’attribution des indemnités suite à sa rétrogradation par l’institution qui l’employait. Toutes les conditions de l’action d’un fonctionnaire communautaire contre son employeur étaient dès lors réunies (A), donnant lieu à la saisine à titre exclusif du juge communautaire, sur la base de recours spécifiques (B).
- LES CONDITIONS DU CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE
La Cour communautaire jugea avec une grande sévérité le manque de rigueur des juges de Bangui : « En réalité il incombait en l’espèce aux juridictions nationales centrafricaines à partir des indications factuelles du litige, de rechercher dans les règles de droit internes de leur Etat, si elles étaient compétentes ratione materiae pour connaître d’un recours dirigé par un fonctionnaire contre une institution spécialisée de la Communauté, en l’occurrence l’Ecole Inter – Etats des Douanes » . A notre sens, ces manquements caractérisant une saisine mal orientée doivent être partagés avec la défense. En effet, ab initio, le dossier présenté par le client, puis le justiciable DJEUKAM contenait deux éléments d’extranéité orientant vers une consultation au moins sommaire de textes communautaires, généraux ou particuliers : la qualité professionnelle du requérant qui appartenait au corps de la fonction publique communautaire et le rattachement communautaire de l’institution défenderesse, l’Ecole inter-Etats des douanes, institution communautaire spécialisée. Ils constituaient déjà les deux conditions imposant dès lors le recours au juge de N’djamena et aucunement à l’un des juges du système juridictionnel centrafricain.
- Un fonctionnaire communautaire
L’article 4 de la Convention régissant la CJ-CEMAC est le texte de référence des compétences de la juridiction communautaire, qui ne sont que des compétences d’attribution. Concernant le contentieux de la fonction publique communautaire, l’alinéa dernier de cet article dispose que : « Dans son rôle juridictionnel, la Cour de Justice rend, en dernier ressort, des arrêts sur les cas de violation des Traités de la C.E.M.A.C. et des Conventions. (…). Elle est juge, en premier et dernier ressort, des litiges nés entre la C.E.M.A.C. et les Agents des Institutions de la Communauté, à l’exception de ceux régis par des contrats de droit local » . Le caractère exclusif de cette compétence de la CJ-CEMAC est clairement exprimé par l’article 21 de la même Convention : « La Chambre Judiciaire connaît en premier et dernier ressort des litiges entre la Communauté et ses agents ».
Le terme « agent » englobe les différences de positions professionnelles que reflète le corps de la fonction publique communautaire . Cependant, les deux Règlements qui organisent les relations entre la CEMAC et ses agents visent les « fonctionnaires » respectivement du Secrétariat exécutif et de la Communauté. Les deux premiers règlements visaient le « personnel » de la CEMAC. Ces deux règlements sont appelés à cohabiter, car le dernier, intervenu seulement en 2009 n’abroge que les dispositions antérieures contraires, selon son article 122. On est donc admis à penser que le règlement n° 08 continuer de s’appliquer dans ses dispositions conformes. Comme texte de base régissant les relations entre les agents et la Communauté, les définitions relatives à la qualité de « fonctionnaire » doivent être recherchés dans ces Statuts. L’étude s’en tiendra au seul règlement de 2009 essentiellement pour éviter les réécritures.
Reprenant l’article 1er du Statut des fonctionnaires de 1999, l’article 2 du statut de 2009 donne la définition suivante du fonctionnaire de la CEMAC, somme toute simple : « Il s’agit de toute personne nommée et titularisée dans l’un des emplois permanents ouverts dans les services d’une Institution, d’un Organe ou d’une Institution de la CEMAC ». Il se distingue ainsi de l’agent contractuel et de l’agent local. Le premier est un fonctionnaire communautaire dont la durée de service est contractuellement limitée et le second, un agent non intégré au corps des fonctionnaires communautaires et dont le statut reste régi par le droit national.
La position juridique de vacataire, occupée par le Sieur DJEUKAM, a-t-elle pu déterminer le recours plutôt à un juge national, sur la base de ce qu’il serait lié à EIED par un contrat de droit local ? L’hypothèse n’a pas été évoquée dans l’arrêt, et elle semble au demeurant peu plausible, au regard des fonctions de chef de Département qui lui furent ultérieurement confiées. Toutefois, elle s’avère sensible car, dans l’affaire ASSIGA AHANDA, cadre contractuel de la BEAC victime d’une mesure de rétrogradation, l’institution d’émission soulevait à titre liminaire le défaut de qualité du requérant, personnel contractuel, pour contester son droit de saisine de la CJ-CEMAC dans le cadre du contentieux des fonctionnaires communautaires. La réponse du juge, maladroitement motivée à notre sens, tendait à rejeter ce moyen, l’article 13 de l’Acte Additionnel n° 04/O0/CEMAC – 041 – CCE – CJ – 02 portant Règlement de procédure de la Chambre Judiciaire n’ayant pas selon lui spécifié le lien juridique qui devrait exister entre l’institution communautaire et l’agent qui la poursuit.
- Une institution communautaire
Le fonctionnaire communautaire doit saisir la CJ-CEMAC pour tout litige l’opposant à l’institution qui l’emploie, selon les prescriptions claires de l’article 4 de la Convention régissant la CJ-CEMAC. Il convient derechef de citer, pour des raisons de présentation, ledit article 4 en son dernier alinéa : « Dans son rôle juridictionnel, la Cour de Justice rend, en dernier ressort, des arrêts sur les cas de violation des Traités de la C.E.M.A.C. et des Conventions. (…). Elle est juge, en premier et dernier ressort, des litiges nés entre la C.E.M.A.C. et les Agents des Institutions de la Communauté, à l’exception de ceux régis par des contrats de droit local » .
D’entrée de jeu, on peut constater la généralité de l’usage, dans l’article précité, du terme « institution ». Une telle lecture est d’autant plus indiquée que le législateur a dans un premier temps fusionné la CEMAC et les institutions qui emploient les fonctionnaires ici évoqués. Cette fusion s’avère réaliste : dans la procédure contentieuse, la Commission, qui représente la CEMAC devant la Cour, se substitue aux institutions et organes communautaires devant la CJ-CEMAC.
Il existe en effet une logique de définition institutionnelle acquise depuis le Traité de N’djamena, certes critiquée , qui permet de distinguer, au sens de son article 2 : les Institutions proprement dites, des organes et des institutions communautaires spécialisées.
Les institutions proprement dites, au nombre de cinq, renvoient aux deux Unions, base de la construction du processus d’intégration, l’Union économique de l’Afrique centrale (UEAC) , l’Union monétaire de l’Afrique centrale (UMAC) et aux deux organes de contrôle : le Parlement communautaire , la Cour de justice communautaire . L’éclatement de celle-ci en deux Cours distinctes, la Cour de justice communautaire et la Cour des Comptes communautaires a quelque peu modifié la configuration institutionnelle de la CEMAC du Traité de 2008 . Cadre de conception des politiques communautaires, ces institutions proprement dite ne disposent pas de compétences normatives directe, exceptée par voie de décisions, catégorie d’acte communautaire propice aux prescriptions individuelles dont aucune institution ne peut faire l’économie, au moins du fait de la nécessaire gestion de leurs ressources humaines.
Les Organes, eux, disposent d’un véritable pouvoir normatif dans la CEMAC, comme cadre d’élaboration des politiques communautaires. Ils étaient au nombre de 8 selon le Traité de N’djamena. Ils sont désormais 7 à la suite de la réforme. La Conférence des Chefs d’Etat adopte le Traité, les Conventions et les Actes additionnels au Traité. Le Conseil des Ministres de l’Union Economique de l’Afrique Centrale et le Comité Ministériel de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale, sont habilités à prendre les règlements, les règlements-cadre, les directives. La Commission de la CEMAC, la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (B.E.A.C.) , la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) , l’Institution de Financement du Développement adoptent, les règlements d’application. Dans le traité révisé, cet institut a été soustrait de la liste des Organes communautaires, remplacée par la BDEAC. Seul le Comité inter-Etats, antichambre du Conseil des ministres de l’UEAC, ne disposait d’aucune compétence normative propre. Il ne fait d’ailleurs plus partie de la liste des organes, depuis le Traité de Yaoundé. Aussi, les organes sus identifiés partagent cette compétence normative avec les « premiers responsables » des institutions (ou organismes) spécialisées, aussi diversifiés que le champ de cette intégration est vaste.
Les institutions spécialisées, cadre par excellence d’exécution des politiques communautaires, sont par conséquent pléthoriques. Elles sont rattachées soit à l’Union économique de l’Afrique centrale (UEAC), soit à l’Union monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC). Dans la première Union, la création de nouvelles institutions communautaires spécialisées a rendu obsolète la liste établie par l’Acte Additionnel n° 08/CEMAC-006-CCE-2 du 14 décembre 2000 portant liste des Institutions spécialisées de l’UEAC. En guise d’exemple, la Communauté économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques (CEBEVIRHA) , Ecole Inter Etats des douanes (EIED) , sont rattachées à l’UEAC. L’UMAC elle s’attribue notamment la Commission de surveillance des marchés financiers (COSUMAF) et le Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC).
A côté de ces institutions au sens large, telle que définies par l’article 10 du Traité révisé, on se doit d’inscrire les ramifications issues de la subdivision fonctionnelle des grandes institutions, organes et institutions spécialisées. Elle a abouti à la création d’autorités sectorielles, sorte de bras armés pour ces derniers. On y compte, notamment, l’autorité boursière et l’autorité communautaire de la concurrence , dont les décisions font partie des actes communautaires ici appréhendés, et qui, du fait de leur émanation, fondent la compétence du juge communautaire.
L’avènement d’une Cour de justice dans la CEMAC a heurté la souveraineté juridictionnelle de certaines institutions communautaires. La BEAC spécialement, a audacieusement soutenu devant cette haute juridiction qu’elle disposait d’une « immunité de juridiction », la rendant incompétente à connaître des recours engagés à son encontre. Elle s’appuyait sur les dispositions des accords de siège, qui effectivement, prévoient une immunité de juridiction dans chacun des Etats partie. Mais, depuis le 31 mai 2007, date de sa jurisprudence ASSIGA AHANDA , la Cour ne fait que rappeler que : « s’il est constant que l’article 8 de l’accord de siège entre le Cameroun et la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) confère à celle-ci une immunité de juridiction, il n’en reste pas moins vrai que cet accord ne porte que sur les relations entre le Cameroun et la BEAC ; il résulte donc que l’immunité de juridiction qu’il institue se limite aux juridictions camerounaises qui ne peuvent connaître d’un litige contre cette Banque qu’en application des dispositions de l’article 16 dudit accord de siège instituant un tribunal arbitral ; Ce point est à rejeter comme mal fondé » .
Par ailleurs, certaines institutions comme la BDEAC ont prévu dans leur statut une clause compromissoire qui impose le recours à l’arbitrage comme moyen de règlement des litiges de travail. Ce statut semble ainsi a priori exclure la compétence juridictionnelle de la CJ-CEMAC. Admettant implicitement la validité d’une telle clause, la Cour a cependant affirmé sa compétence dès lors qu’il apparaît que les parties ont renoncé à la clause compromissoire. Ainsi, grande ou petite, toute institution communautaire est-elle soumise à la juridiction de la CJ-CEMAC.
Tout acte émanant de ces institutions, organes ou institutions communautaires spécialisées, ou autorité sectorielle rattachée à la Communauté, est par cette filiation naturelle un « acte communautaire ». Il peut relever soit de la catégorie des actes communautaires primaires, soit de celles des actes communautaires dérivés, seuls susceptibles d’une appréciation préjudicielle. C’est un acte appartenant à la cette dernière catégorie qui était en question dans l’affaire DJEUKAM.
- LES RECOURS ADMIS DANS LE CADRE DU CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE
Le fonctionnaire communautaire offre aujourd’hui la majorité de son contentieux à la Cour de justice de la CEMAC. Monsieur Djeukam disposait, en lieux et places d’un recours en indemnisation devant le Tribunal de travail de Bangui, de deux recours potentiels devant le juge de N’djamena : le recours en annulation et le recours en indemnisation. Une observation de la jurisprudence de la Cour donne à apprécier une utilisation de plus en plus régulière du premier, le second intervenant à titre de demande accessoire.
- Le recours en annulation
En tant que recours direct, le recours en annulation apparaît en matière de contentieux de la fonction publique communautaire comme le recours de prédilection, aussi mérite-t-il un rappel du juge de N’djamena dans son arrêt n° 001 du 25 novembre 2010 : « Au surplus, à supposer qu’elle soit illégale, cette décision peut être attaquée également par le biais d’un recours en annulation par le fonctionnaire intéressé ». Le recours préjudiciel permet, dans le cadre d’une procédure nationale, de faire procéder au contrôle de la légalité d’un acte communautaire ; il s’agit d’un recours réservé au juge national ; le recours en annulation reste le recours de « droit commun » communautaire dans toutes les hypothèses d’illégalité. Il est posé par l’article 4 de la Convention régissant la Cour de justice de la CEMAC. Aux termes de ce texte, « dans son rôle juridictionnel, la Cour de Justice rend, en dernier ressort, des arrêts sur les cas de violation des Traités de la C.E.M.A.C. et des Conventions subséquentes dont elle est saisie conformément à ses règles de procédure ».
Le bilan actuel du contentieux de la fonction publique communautaire donne à apprécier l’émergence d’une jurisprudence de plus en plus constante sur les conditions d’exercice du recours en annulation. Il impose, aux termes de l’article 113 de l’ancien Statut des fonctionnaires et agents du secrétariat exécutif et de l’article 119 du nouveau Statut des fonctionnaires de la Communauté, deux conditions à peine d’irrecevabilité de la requête en annulation : le respect d’une phase interne de réclamations préalables et le respect des délais de recours.
Au sens de l’article 119 du nouveau statut des fonctionnaires communautaires, la recevabilité des requêtes de fonctionnaires est soumise au respect d’une phase interne composée de deux réclamations préalables, dont l’une est subordonnée au rejet de l’autre. La première, adressée au Comité Consultatif de Discipline. Un tel Comité doit, le cas échéant, être créé dans chacune des institutions communautaires, au sens large. La seconde réclamation est adressée à l’« autorité compétente » , en cas de rejet partiel ou total, implicite ou explicite, de la réclamation adressée au Comité consultatif de discipline. L’article 113 du Statut des fonctionnaires de la Commission impose une procédure identique.
Les deux réclamations sus évoquées, comme la saisine ultérieure du juge communautaire, sont encastrées dans une suite de délais. Selon l’article 115 du nouveau Statut des fonctionnaires de la Communauté, la saisine du Comité Consultatif de Discipline doit être faite dans un délai de deux mois, à compter :
- « du jour de publication de la décision, s’il s’agit d’une mesure de caractère général ;
- du jour de la notification de la décision au destinataire, et en tout cas, au plus tard, du jour où l’intéressé en a eu connaissance, s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel ;
- de la date d’expiration du délai de réponse, lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens de l’article 114 ci-dessus ».
Ce Comité dispose un délai d’un mois pour émettre un avis (article 117). Son silence vaut avis implicite de rejet. Dès lors, le fonctionnaire dispose peut saisir l’autorité compétente, qui doit se prononcer dans un délai de 2 mois (article 118). S’il juge la réponse de cette autorité négative ou insuffisante, le fonctionnaire doit saisir la Cour, au sens des articles 119 du statut des fonctionnaires et 113 du Statut des fonctionnaires du Secrétariat exécutif, dans un délai de 3 mois à compter de :
- « de la date de publication de la décision ou ;
- de la date de sa notification au fonctionnaire ou ;
- du jour l’intéressé en a eu connaissance ;
- ou de la date d’expiration du délai de réponse attendue de l’autorité compétence lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet ».
Ce délai de 3 mois est, selon une jurisprudence constante de la Cour, d’ordre public.
En définitive, le recours en annulation dans le contentieux de la fonction publique communautaire est soumis à une somme importante de conditionnalités procédurales qui auraient pu décourager les principaux concernés. A contrario, on note, comme signe du dynamisme de la CJ-CEMAC, que toutes les différentes formes d’illégalité explorées dans cette étude sont parfaitement illustrées dans la jurisprudence de la CJ-CEMAC, qu’il s’agisse de la légalité interne ou de la légalité externe. Le recours en annulation apparaissait, comme le préconisait le juge de Ndjamena, la voie de recours idoine dans l’affaire DJEUKAM, recours qu’il aurait pu assortir d’une demande en indemnisation.
- Le recours en indemnisation
Seul le recours en annulation fut rappelé par le juge communautaire comme recours pour demander l’appréciation de légalité d’un acte communautaire ; il s’agissait ainsi pour cette autorité de faire œuvre pédagogique. Pour parachever cet enseignement, il s’impose de souligner que M. DJEUKAM disposait, en sus de ce premier droit, celui de solliciter la réparation du préjudice qui inévitablement aurait découlé de l’illégalité. Le contentieux de la responsabilité extracontractuelle qui rentre dans le cadre du contentieux de pleine juridiction est en effet fondé sur une voie de recours autonome, expressément prévue par l’article 20 de la Convention régissant la CJ-CEMAC : « La Chambre Judiciaire connaît, en dernier ressort, des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les Organes et Institutions de la Communauté ou par les agents de celle-ci dans l’exercice de leurs fonctions (…) ». Le droit du fonctionnaire de saisir le juge communautaire dans ce cadre présuppose qu’il dispose au préalable d’une qualité à agir ; elle lui est ouverte par l’article 4 al. 4 de la Convention régissant la Cour.
La Chambre judiciaire dispose d’une compétence exclusive à connaître des actions contre les agissements illégaux et dommageables des institutions, agents ou organes de la Communauté. Ces dommages peuvent être portés par un acte causant un grief au plaignant du fait de son caractère illégal.
Exercé par un fonctionnaire communautaire, les conditions de ce recours sont toutes aussi strictes, car elles imposent, comme le contentieux en annulation, le respect de la phase interne des réclamations préalables. Relativement à l’institution communautaire poursuivie, le dommage doit avoir été causé par une institution communautaire dans le cadre de la réalisation des missions à elle confiée par la Communauté : c’est tout le sens de la jurisprudence Marcel DOBILL C/ BEAC.
Relativement aux délais de recours, avant 2009, l’absence d’une jurisprudence claire obligeait à une réponse assortie d’une alternative. Soit les recours en responsabilité émanant des fonctionnaires communautaires étaient seuls assujettis aux délais des articles 119 et 113 sus évoqués, soit comme l’avait décidé le juge, ces délais ne concernaient que les recours en annulation . Cette dernière hypothèse laissait intacte la question du délai de recours en indemnisation. Aujourd’hui, sous réserve des règles spéciales suscitées concernant les fonctionnaires communautaires dont l’application nécessite encore des éclaircissements, cette question peut être considérée comme levée par l’article 38 de la nouvelle Convention régissant la CJ-CEMAC. Il fixe pour l’avenir ce délai à 5 ans, à compter de la survenance du fait générateur de responsabilité, comme en droit européen.
Somme toute, selon les prescriptions claires de l’article 20 de la Convention régissant la CJ-CEMAC. Dans le cadre du contentieux de la responsabilité, « (…). Elle [la Cour] statue en tenant compte des principes généraux de droit qui sont communs aux droits des Etats membres ». 5 des 6 Etats membres (à l’exception de la Guinée équatoriale, ex colonie espagnole) ont en commun l’application de la théorie de la responsabilité issue du code civil français transposé dans les systèmes juridiques des anciennes colonies. Elle est usitée tant dans les procédures civiles qu’administratives. Ces principes classiques d’appréciation de la responsabilité, découlant de l’article 1382 sont connus à savoir : une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage . En somme, la faute s’analyse en une illégalité, le dommage étant constitué du grief qui a été causé au requérant. Le lien de causalité est la démonstration faite par ce dernier de ce que le grief est la résultante de l’illégalité.
Une observation de la jurisprudence de la Cour révèle une admission difficile de la responsabilité communautaire par le juge de Ndjamena. Il est certain que nombre d’actions en réparation sont jugées irrecevables au regard des seules conditions de recevabilité, signe d’une non maitrise du droit communautaire tant par les fonctionnaires communautaires que par leurs conseils. Dans d’autres, la faute n’est pas constituée, sans que l’on puisse imputer au juge une appréciation stricte. Cependant, l’affaire MOKAMANEDE, malgré ses péripéties, constitue une jurisprudence positive sur le point de la condamnation effective des institutions communautaires par le juge de N’djamena. Ce fonctionnaire communautaire fut deux fois victime d’un licenciement illicite : la première par son autorité hiérarchique, dans l’irrespect des conditions de forme, la seconde par le Conseil des ministres de l’UEAC, autorité incompétente et par une décision au demeurant non motivée. Il obtint l’annulation de l’une comme de l’autre décision. Mais il ne put obtenir l’indemnisation, demandée conjointement à son recours en annulation dans la première procédure. Une troisième procédure, cette fois uniquement fondée sur le recours en indemnisation, devrait être engagée afin que le juge communautaire réponde de manière explicite sur cette demande manifestement fondée.
Par MARIE-COLETTE KAMWE MOUAFFO
Docteur en Droit -enseignant – Chercheure
Université de Ngaoundéré