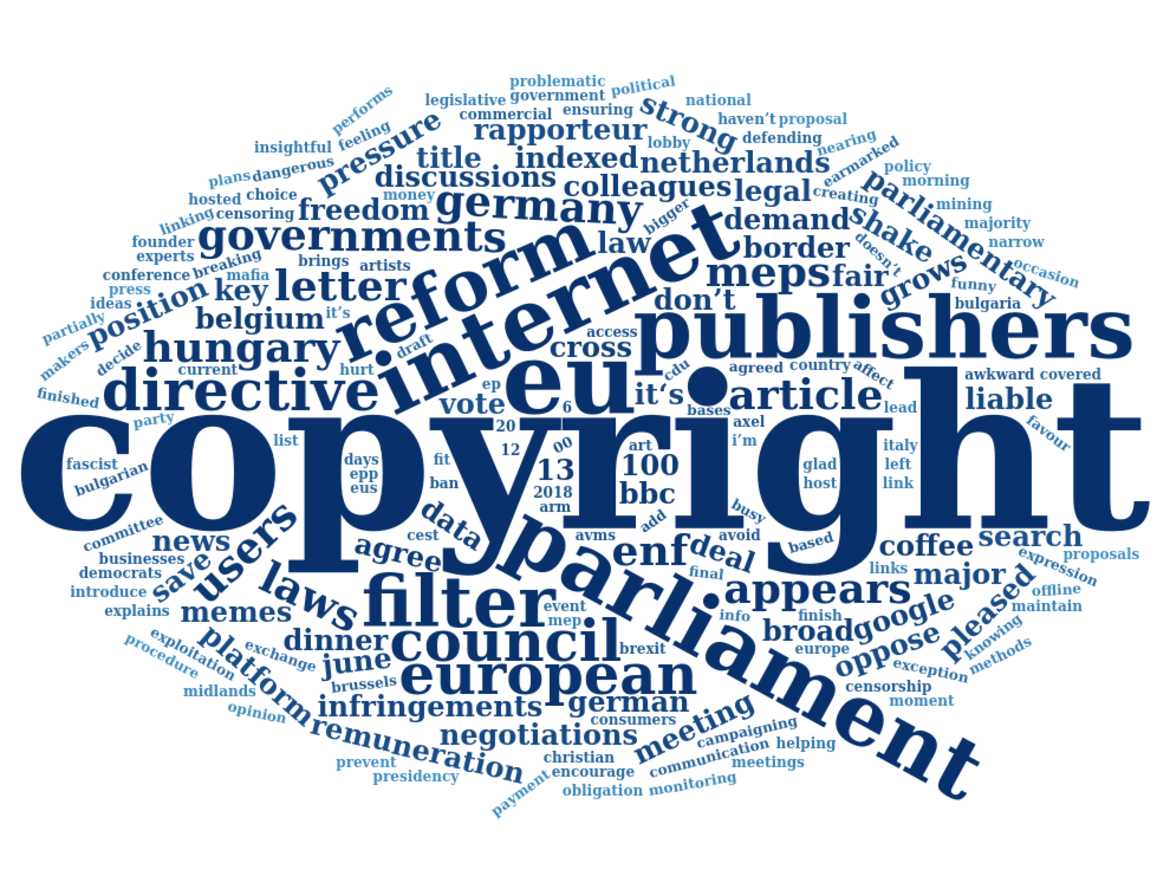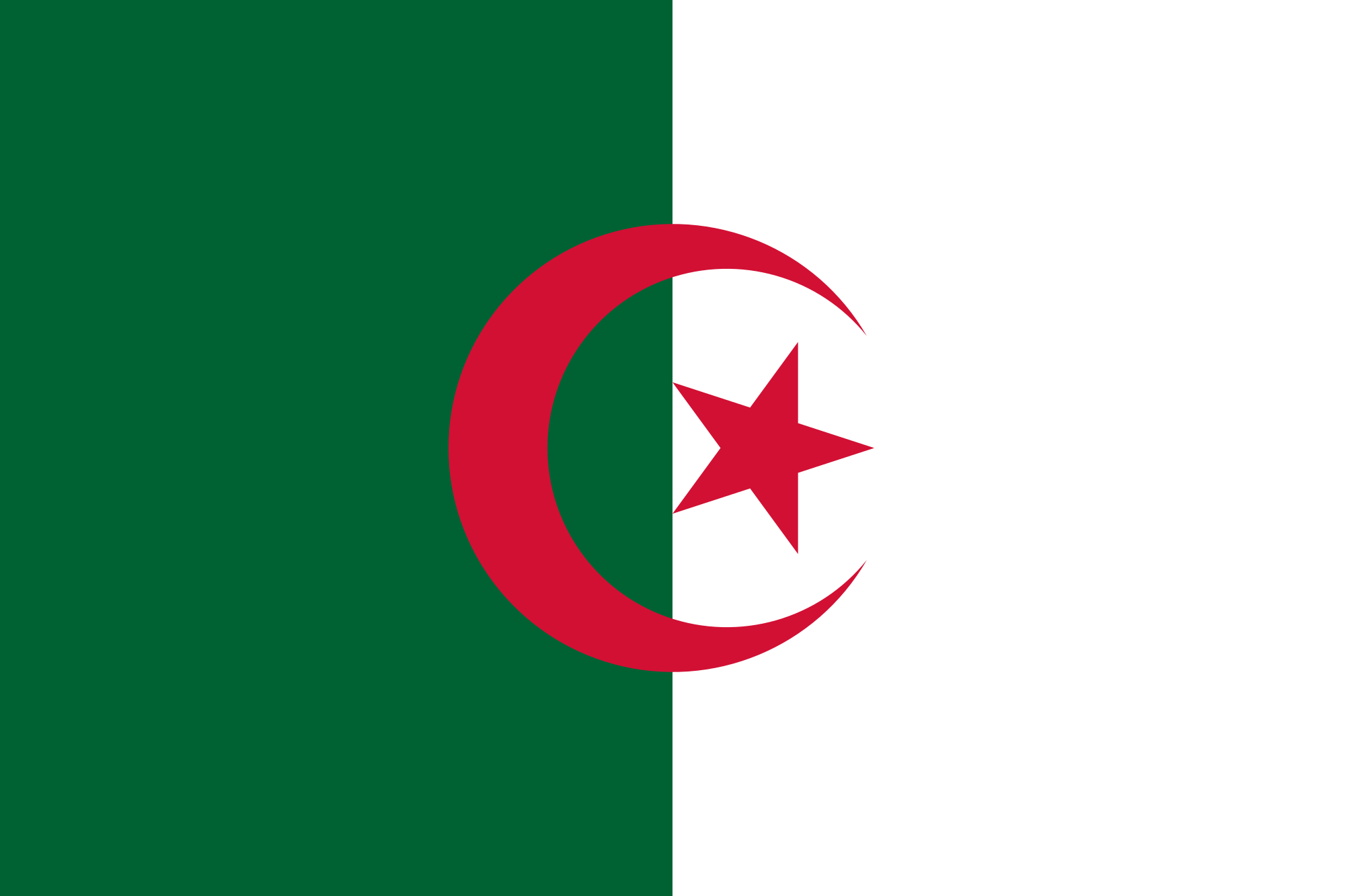Pour qui est coutumier des différends de souveraineté territoriale ou de ceux portant tout simplement sur la délimitation des frontières internationales entre Etats, l’annonce faite par deux Etats d’Afrique centrale de porter leur contentieux devant une instance judiciaire internationale vient redonner du baume au cœur, tant, en de telles occurrences, l’option pour le recours au juge ne représente pas toujours le commun dénominateur entre les protagonistes.
Le 15 novembre 2016 à Marrakech en effet, en marge de la 22ème Conférence des Parties (COP22) les Présidents gabonais et équato-guinéen ont procédé à la signature d’un Accord soumettant à la Cour internationale de justice (CIJ), le différend frontalier opposant leurs deux pays au sujet de la souveraineté sur l’île de Mbanié et les îlots voisins.
Cette signature qui témoigne de la volonté des deux Etats de trouver une solution définitive à leur litige, a été saluée à juste titre par le Secrétaire général de l’ONU, en ce qu’elle traduit, de la part des Parties, un attachement aux principes et valeurs de la Charte de l’Organisation des Nations Unies.
L’Accord signé 15 novembre 2016 à Marrakech constitue un acte d’une importance capitale pour la suite du contentieux vieux de près d’un demi siècle, au regard de sa double porté juridique et politique, et du processus (commencé depuis plusieurs décennies) qui a abouti à sa signature par les Parties.
I.- Historique du différend
Mbanié est une île d’une vingtaine d’hectare de superficie, située à environ 16km et 36km des côtes gabonaises et équato-guinéennes respectivement. A son voisinage, se trouvent l’île de Cocotiers et l’îlot de Conga.
Cet ensemble d’île est sous administration effective du Gabon. Mais depuis 1972, lorsque feu le Président gabonais Omar Bongo se rend à Mbanié et y implante le drapeau de son pays, la Guinée Equatoriale proteste contre ce qu’elle considère comme un acte de provocation. Depuis lors, Malabo conteste la souveraineté de Libreville sur Mbanié et les îles voisines.
Le Gabon déclare tenir sa souveraineté sur les îles querellées de la Convention franco-espagnole du 27 juin 1900 par laquelle les deux puissances coloniales définissaient les limites de leurs possessions, ainsi que de la Convention du 12 septembre 1974 démarquant les frontières maritimes et terrestres des deux Etats.
La Guinée Equatoriale quant à elle, faisant observer que ces îles étaient restées possessions espagnoles avant son indépendance, conteste que la Convention de 1900 ait attribué à la France et par conséquent au Gabon, ces formations insulaires. Idem de la Convention de 1974. C’est donc tout naturellement que par un Décret du 2 juin 1999 définissant sa Zone économique exclusive ainsi que sa frontière latérale avec le Gabon, elle introduit, sous sa juridiction, les iles susmentionnées. Ce à quoi le Gabon réagit en publiant un Décret du 11 octobre 1999 réaffirmant sa souveraineté sur les zones litigieuses.
Avec la montée de tensions entre les deux pays, va se mettre en branle une série de tentatives de médiation destinées à rapprocher les protagonistes. Cette médiation emprunte, dans un premier temps, la voie sous régionale et régionale avant de recourir à l’instance onusienne.
Sur le plan régional, le Gabon et la Guinée Equatoriale vont bénéficier notamment de la médiation du Président de l’ex-Zaïre, le Maréchal Mobutu Sese Seko et de celle de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA), ancêtre de l’Union Africaine (UA). L’échec de la médiation menée au niveau sous-régional et régional amène les Parties à recourir, dès 2003, à l’ONU.
La médiation menée par l’Organisation des Nations Unies a connu deux phases. La première (de 2003 à 2006), visait prioritairement à aider les Parties à trouver une solution négociée au différend, sans qu’il soit besoin de recourir à une tierce instance décisoire. Après l’échec de cette médiation, le Gabon et la Guinée Equatoriale reprennent langue en 2008 sous la houlette d’un autre médiateur, le Secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des affaires juridiques.
Après de longues et laborieuses négociations, les Parties acceptent de soumettre le règlement de leur différend à la Cour internationale de justice (CIJ). C’est pour consigner cet engagement dans un instrument juridique que le 15 novembre 2016 à Marrakech (Maroc), les Présidents gabonais et équato-guinéens ont signé l’Accord y relatif.
II.- Portée de l’Accord du 15 novembre 2016
L’Accord signé à Marrakech a une double portée politique et juridique.
D’un point de vue juridique, l’Accord a pour effet d’offrir aux deux Etats, une issue de sortie de l’impasse dans laquelle leurs déclarations ou absence de déclaration les confinait ; en raison du principe de la compétence consensuelle en vertu duquel un Etat ne peut être attrait devant le juge international sans y avoir consenti, chacune des Parties était privée de la possibilité de saisir unilatéralement une instance judiciaire, même pas la Cour internationale de justice.
Bien que la Cour leur soit ouverte en vertu de l’Article 35 de son Statut, ni le Gabon, ni la Guinée Equatoriale n’ont souscrit à la clause facultative de juridiction obligatoire de la CIJ. En effet, Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 36 dudit Statut, « les Etats parties (…) pourront, à n’importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique ayant pour objet :
a) l’interprétation d’un traité; b) tout point de droit international;
c) la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international;
d) la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement international. »
La juridiction de la Cour n’existant que dans les termes où elle a été acceptée (Cf. C.P.J.I., Arrêt du 14 juin 1938, Affaire Phosphates du Maroc, Série A/B, n° 74, 23; et CIJ, Arrêt du 21 juin 2000, Affaire Incident aérien, Rec. 2000, § 36), il fallait bien que les deux Etats procèdent à la signature d’un Accord leur permettant de soumettre leur différend au principal organe judiciaire des Nations Unies.
Sur le plan politique, il traduit l’attachement des deux Etats aux principes et idéaux de la Charte des nations Unies et de celle de l’Union africaine, notamment en ce qui concerne le règlement des différends par la voie pacifique. A cet égard, le succès de la médiation conforte l’ONU dans son rôle de sentinelle de la paix et adresse un signal fort aux autres Etats africains ou non, confrontés à des problèmes similaires.
En outre, l’acte posé le 15 novembre 2016 par les deux Chefs d’Etat traduit leur adhésion au cadre programmatique de l’Union Africaine, relatif aux frontières, notamment le Programme Frontière de l’UA (PFUA). Le PFUA a fixé en 2017, la date à laquelle toutes les frontières interétatiques africaines devraient être délimitées et démarquées.
C’est le lieu d’observer que nombre d’Etats de la sous-région Afrique centrale sont encore en butte à des problèmes de frontières, soit parce que celles-ci ne sont pas délimitées, soit en raison de ce que bien qu’étant délimitées, elles n’ont pas encore été démarquées. Le Cameroun et la Guinée Equatoriale par exemple n’ont pas encore procédé à la délimitation de leur frontière maritime.
Gageons que l’acte consensuel du 15 novembre 2016 inspirera les Etats de la sous région Afrique centrale – généralement peu coutumiers des contentieux de souveraineté territoriale ou de délimitation – dans leur quête pour des frontières sûres et définitives.
lire l’original de cet article soumis à sentinelle par M. Michel Djoumeni, qui est chercheur au ministère des affaires étrangères au Cameroun.