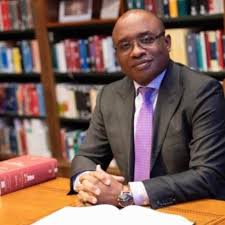« Il ne paraît pas judicieux de conserver la réglementation foncière dans son état actuel »
Rissouck à Moulong : à l’occasion de l’audience solennelle de la Cour suprême consacrée à la rentrée de l’année judiciaire 2013, le procureur général près la haute juridiction a délivré une réflexion autour du titre foncier dans la « consécration des droits fonciers au Cameroun ». En voici le contenu.
La question foncière dans notre pays semble être entrée dans l’ordre de l’éternité du fait de son actualité sans cesse renouvelée. Comme le déclare Monsieur Tchapmegni Robinson lors d’un colloque organisé à Mbalmayo sur le mécanisme camerounais de résolution des conflits fonciers, je cite : « Les conflits fonciers font de plus en plus partie des grandes préoccupations tant des populations que des pouvoirs publics. Certains de ces conflits se perpétuent au fil du temps ; sans que ni les collectivités coutumières ; ni leurs membres, ni l’Etat ne puissent rien faire pour les « régler de manière définitive ». Ces conflits opposent les membres d’une même famille, les familles d’une même collectivité villageoise parfois des communautés tribales entres elles, voire des communautés tribales contre l’Etat. On se rend compte que les conflits fonciers dépassent la sphère familiale pour devenir un problème national ».
Conscient de l’importance socio-économique de la terre, le législateur s’est employé à en organiser la gestion. Alors que dans la partie du pays sous administration anglaise, l’accès à la terre avait pour but de permettre à la population d’utiliser et d’exploiter la terre, disposant ainsi d’un droit de jouissance et non de propriété par le biais du « certificate of occupancy », le décret colonial du 21 juillet 1932 institua au Cameroun sous tutelle française le régime de l’immatriculation.
Les ordonnances N°74/1,74/2 et 74/3 du 06 octobre 1974 fixant respectivement le régime foncier, le régime domanial et la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, leurs textes modificatifs et les décrets d’application viendront unifier les deux systèmes. Désormais, seules les terres immatriculées peuvent faire l’objet du droit de propriété et circuler « dans le commerce » ; les terres non immatriculées » reviennent à l’Etat qui se réserve la prérogative de les distribuer selon les nécessités du développement de la nation.
Dans son édition du 26 novembre 2011, un quotidien de la place a publié un article intitulé « Terres agricoles : plaidoyer pour une cession transparente ». Dans cet article, le journal révèle que les demandes de cession de terres à grande échelle à des fins agricoles ont porté sur une superficie comprise entre 1,6 et 2 millions d’hectares en fin septembre 2011. Il précise que le palmier à huile, le maïs, l’hévéa sont les principales cultures développées sur lesdites terres et que l’augmentation depuis 2008 de la demande de terres à des fins agricoles appelle à un « Plaidoyer pour une réforme du régime juridique des cessions de terres à grande échelle en Afrique Centrale ».
Le 24e Congrès des Notaires d’Afrique qui s’est tenu à Yaoundé du 27 ou 30 novembre 2012 avait pour thème principal « sécurité juridique du marché immobilier : la nécessité d’instruments de régulation ». Certains intervenants dans le cadre de l’atelier sur « les enjeux et les opportunités de la gouvernance des régimes fonciers en Afrique francophone » organisé en décembre 2012 à Yaoundé par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) n’ont pas hésité à affirmer que le développement de l’agriculture pourrait être hypothéqué par l’absence des terres ou que la prochaine guerre du 21e siècle sera celle de la terre et de l’eau potable.
Dans son rapport 2011, la Commission nationale anticorruption (CONAC), dévoile une autre facette de cette problématique en faisant, entre autres, état d’une criminalité à col à blanc sur des indemnisations pour cause d’utilité publique dans le cadre du projet du Complexe industrialo-portuaire de Kribi.
La représentation nationale n’a eu de cesse d’interpeller le gouvernement sur les problèmes de la terre. La terre fait en effet l’objet de pressions multiformes dont celles émanant des demandes accrues ou des cessions à grande échelle à des fins agricoles, celles résultant dans nos villes, des besoins en habitat et espaces vers auxquelles il convient d’ajouter, celles relatives aux exigences de la conservation de la biodiversité et la protection des écosystèmes. De ces pressions naissent des problèmes environnementaux dont la dimension ne saurait être négligée.
L’abondant contentieux devant les Cours et Tribunaux en vue de la consécration des droits fonciers, de leur protection ou pour la réparation des préjudices soufferts à la suite des atteintes à ces droits est une autre illustration de l’importance des enjeux. (D’où l’opportunité de réfléchir) sur « la consécration des droits fonciers au Cameroun : le cas du titre foncier »
« La spéculation foncière qui sévit maintenant de façon exponentielle dans les grands centres urbains, provient souvent de l’immatriculation frauduleuse des terres par des citoyens nantis et ce, au détriment des populations jadis détentrices desdites terres. C’est ainsi que le prix du mètre carré dans les grandes agglomérations urbaines atteint des dizaines de milliers de francs, sans que l’on puisse le justifier, surtout dans un pays où le revenu du citoyen moyen atteint difficilement 50 000 francs le mois ».
Pour aborder ce sujet délicat, il m’a semblé nécessaire de rappeler le cadre institutionnel dans lequel l’Etat s’efforce de garantir la propriété foncière, avant de m’interroger sur la pertinence des mesures arrêtées par les pouvoirs publics pour y faire face.
Cadre institutionnel
Dans son préambule, la Constitution du 02 juin 1972 révisée par la loi N°96/06 du 18 janvier 1996, dispose entre autres que la propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait en être privé si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi. Le droit de propriété ne saurait être exercé contrairement à l’utilité publique, sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l’existence ou la propriété d’autrui.
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance N°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, l’Etat garantit à toutes les personnes physiques ou morales possédant des terrains en propriété, le droit d’en jouir et d’en disposer librement.
L’Etat est le gardien de toutes les terres. Il peut, à ce titre, « intervenir en vue d’en assurer un usage rationnel ou pour tenir compte des impératifs de la défense ou des options économiques de la Nation ».
Le décret N°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier, modifié et complété par celui N°2005/481 du 16 décembre 2005 dispose en son article 1er que « le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière ». Sous réserve des dispositions des articles 2 alinéa 3 et 24 du présent décret, le titre foncier est inattaquable, intangible, définitif. Il en est de même des actes constatant les autres droits réels attachés à la propriété.
L’enregistrement d’un droit dans un registre spécial appelé livre foncier emporte immatriculation de ce droit et le rend opposable aux tiers. En vue de la promotion des droits fonciers, une réglementation répressive a été adoptée.
Le décret du 21 juillet 1932 sus évoqué incriminant le stellionat, l’altération des titres fonciers et duplicata de titres fonciers, la destruction, la dégradation et le déplacement des signaux géodésique ou topographiques et des bornes d’immatriculation.
Ces dispositions ont été remplacées par celles du Code pénal issu de la loi N°67/LF/1 du 12 juin 1967, de l’ordonnance N°74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier déjà évoqué, et surtout de la loi N°80/22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale. Les atteintes incriminées concernent notamment la contrefaçon des écrits attestant d’un droit foncier (art.314 01 2-b du code pénal), l’aliénation ou la location d’immeubles appartenant à autrui (art.8 01.3 et 4 de l’ordonnance 74/1du 6 juillet 1974).
Hormis certaines contraventions de première, deuxième et troisième classes, sont réprimées la reprise d’un immeuble (art.182 du code pénal), la destruction de borne ou de clôture (art.317 du code pénal), l’atteinte à la propriété foncière et domaniale proprement dite des articles 2,3 et 4 de la loi N°80/22 du 14 juillet 1980 telle que modifiée.
L’on pourrait aussi y ajouter l’article 239 du code pénal réprimant le trouble de jouissance. Cette disposition s’applique même si la victime des faits n’est pas propriétaire, à condition de justifier d’une occupation paisible des lieux litigieux. Les agents de l’Etat complices des transactions foncières de nature à favoriser l’aliénation ou l’occupation irrégulière de la propriété d’autrui sont également possibles pénales.
Les délits attentatoires à la propriété foncière et domaniale sont tous punis d’une peine privative de liberté parfois assortie d’une amende. L’emprisonnement peut aller jusqu’à 10 ans et l’amende jusqu’à 2 millions de francs, notamment dans l’hypothèse de la falsification d’un écrit attestant d’un droit foncier (art.314 al.2-b du code pénal). L’évolution législative se caractérise du reste par la tendance à une sévérité toujours plus accentuée : l’atteinte à la propriété foncière, naguère sanctionnée d’un emprisonnement de 15 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 25 000 à 100 000 fcfa par l’article 8 de l’ordonnance N°74/1 du 6juillet 1974, est désormais passible d’une peine de 2 mois à 3 ans d’emprisonnement et/ou 50 000 à 200 000 fcfa d’amende.
A ces peines principales s’ajoute en cas d’atteinte à la propriété foncière elle-même, la peine accessoire de déguerpissement de l’occupant à ses frais, que l’atteinte ait porté sur un terrain privé ou sur une propriété domaniale.
L’article 3 de la loi N°80/22 du 14 juillet 1980 dispose par ailleurs que la « mise en valeur réalisée sur ledit terrain sous forme de plantations, de constructions ou d’ouvrages de quelque nature que ce soit est acquise de plein droit au propriétaire sans aucune indemnité pour l’occupant. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions plantations et ouvrages, celle-ci est exécutée aux frais de l’occupant, sans aucune indemnité pour ce dernier qui peut en outre être condamné à des dommages intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds ».
En écartant la distinction selon la bonne ou la mauvaise foi de l’occupant consacrée par l’article 555 du Code civil, la loi N°80/22 du 14 juillet 1980 précitée traite avec une plus grande rigueur s’observe aussi dans la réglementation relative à la gestion administrative de la procédure d’obtention du titre foncier. Elle participe de la sacralisation de ce document.
Le Décret N°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret N°2005/481 du 16 décembre 2005 place l’administration tant en amont qu’en aval de tout le processus. Aux termes de l’article 12 dudit décret, le sous-préfet du lieu de situation de l’immeuble reçoit le dossier de demande de titre foncier, en délivre récépissé dans les 72 heures et le transmet dans les huit jours à la délégation départementale des affaires foncières.
Dès réception du dossier, le délégué départemental des affaires foncières fait publier dans les 15 jours, un extrait de la demande par voie d’affichage dans les locaux du service, de la sous-préfecture, de la mairie et de la chefferie du village concerné. Sur proposition du chef de service départemental des affaires foncières, le sous-préfet territorialement compétent, président de la commission, fixe par décision, la date de constat d’occupation ou d’exploitation.
Lorsqu’il y a plusieurs demandes, il est établi chaque mois, à la diligence du chef de service départemental des affaires foncières, et par décision du sous-préfet concerné, un calendrier des travaux de la commission consultative. En vertu des dispositions de l’art.16 de l’ordonnance N°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, seule la commission consultative est compétente pour établir les constats d’occupation ou d’exploitation des dépendances du domaine national de première catégorie en vue de l’obtention du titre foncier. Quand l’immeuble à immatriculer intéresse plusieurs circonscriptions administratives, les commissions consultatives concernées siègent ensemble, à l’initiative de celle qui détient le dossier. Aux termes de l’article 20 de la même ordonnance, les oppositions ou demandes d’inscription de droits non levées à l’expiration du délai prévu à l’article 18 sont soumises au gouvernement territorialement compétent pour règlement après avis de la commission consultative.
Sur proposition du chef de service régional des affaires foncières, le gouverneur peut par arrêté selon le cas, autoriser le Conservateur Foncier : soit à immatriculer le terrain au nom du requérant, avec inscription des droits, le cas échéant, soit à faire exclure, avant immatriculation, la parcelle contestée, soit enfin à rejeter la demande d’immatriculation. La décision du gouverneur est susceptible de recours hiérarchique devant le ministre chargé des affaires foncières.
Le formalisme qui entoure la délivrance du titre foncier a pour but de lui garantir un maximum de régularité, le moindre dysfonctionnement étant de nature à entrainer le retrait, preuve s’il en était encore besoin, de la volonté manifeste des pouvoirs publics de protéger le droit de propriété consacré par la Constitution.
En raison de la nature administrative de la plupart des actes de gestion du régime foncier et domanial et la procédure d’obtention du titre foncier, les recours contre lesdits actes s’adressent en priorité aux autorités administratives. Au cours de cette phase non contentieuse, le ministre en charge des Domaines et des Affaires Foncières peut, soit constater la nullité d’ordre public du titre foncier, soit en ordonner la rectification.
Le constat de nullité d’ordre public du titre foncier est un instrument de police administrative permettant au ministre en charge des Domaines et des Affaires Foncières de maintenir ou de rétablir l’ordre public en matière foncière domaniale face à des irrégularités menaçant gravement les droits et la sécurité juridique des personnes.
Le recours en rectification est quant à lui prévu par les articles 39 à 40 Décret N°76/165 du 27 avril 1976, modifié par le Décret N°2005/481 précité. La rectification consiste en la régularisation des omissions ou erreurs commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions.
En sus des différents types de recours susmentionnés, l’administration en charge des Domaines et des Affaires Foncières est également saisie de recours multiples portant sur la régularité de divers actes pris par les responsables chargés de la gestion du régime domanial et foncier. Il en est ainsi notamment des actes suivants : la délivrance du certificat de propriété par le Conservateur foncier ; la transformation de divers actes en titres fonciers ; la mutation des titres fonciers.
Suivant leur nature et en vertu du régime général du contentieux administratif, ces actes font l’objet de recours divers auprès des services compétents des Domaines et des Affaires Foncières et sont instruits dans le cadre des règles définies par ledit régime.
A l’issue de cette phase non contentieuse, le demandeur qui n’a pas été satisfait peut intenter un recours devant les juridictions administratives. L’article 18 de la loi N°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux administratifs dispose : « (1) Sous peine de forclusion, les recours contre les décisions administratives doivent être introduits dons un délai de soixante (60) jours à la compter de la décision de rejet du recours gracieux visé à l’article 17. (2) ce délai court du lendemain du jour de la notification à personne ou à domicile élu ».
L’article 17 susvisé rappelle que « le recours devant le tribunal administratif n’est recevable qu’après rejet d’un recours gracieux adressé à l’autorité auteur de l’acte attaqué ou celle statutaire habileté à représenter la collectivité publique ou l’établissement public en cause ». Constitue un rejet du recours gracieux, le silence gardé par l’autorité pendant un délai de trois si une demande ou réclamation lui est adressée. Ce délai court à compter de la notification du recours offre à l’Administration l’opportunité de corriger les irrégularités qu’elle aurait commises.
En outre, l’examen préalable des questions litigieuses par l’administration favorise le règlement rapide des litiges en faisant l’économie de procédures quelquefois longues et coûteuses.
L’annulation est le principal contentieux qui nait des actes administratifs unilatéraux à l’instar de la délivrance du titre foncier. Ce contentieux est prévu à l’article 20 alinéa 4 nouveau du décret N°76/1 65 du 27 avril 1976 modifié qui donne éclairage sur l’article 2 dudit texte en énonçant : « La décision du Ministre chargé des Affaires Foncières est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente ».
Le contentieux de l’annulation a pour fondement la faute de l’administration résultant d’une irrégularité commise pendant la procédure d’obtention du titre foncier. La rémunération énumère plusieurs cas : lorsque plusieurs titres fonciers sont délivrés sur un même terrain ; lorsque le titre foncier est délivré arbitrairement sans suivi d’une quelconque procédure ou obtenu par une procédure autre que celle prévue à cet effet ; lorsque le titre foncier est établi en totalité ou en partie sur une parcelle du domaine privé de l’Etat d’une collectivité publique ou d’un organisme public en violation de la réglementation.
La jurisprudence a aussi dégagé quelques cas d’annulation, et notamment les cas de falsification des pièces du dossier, de non prise en compte des oppositions, d’obtention de visas irréguliers. La fraude du bénéficiaire sert aussi de fondement ou contentieux de l’annulation, l’article 2 alinéa 5 du Décret N°76/165 précisant toutefois que « le retrait du titre foncier prévu à l’alinéa 3 ne peut sauf cas de fraude du bénéficiaire intervenir dans les délais du recours contentieux ».
Mais une partie tout aussi importante du contentieux relève de la compétence du juge judiciaire.
« Avant la crise économique, le titre foncier servait de caution à l’octroi du crédit bancaire. Aujourd’hui, les banques n’accordent plus que difficilement des crédits aux productions ruraux, même garantis par ce document. Dans ces conditions, certains s’interrogent sur l’opportunité d’engager une procédure longue, alors que leurs droits sont consacrés par d’autres moyens. Le coût de la procédure auquel s’ajoute une charge fiscale, modère l’enthousiasme pour l’immatriculation tant que l’usager ne se sent pas menacé.
Le titre foncier est devenu, soit une arme utilisé par les élites pour conquérir des terres, soit un moyen de défense des propriétaires pour parer aux manœuvres d’accaparement ».
Compétence du juge judiciaire
En effet, la loi N°83/19 du 26 novembre 1983 portant modification des dispositions de l’article 5 al.b de l’ordonnance N°74/1 du 06 octobre 1974 fixant le régime foncier, après avoir déterminé les litiges qui relèvent de la compétence des commissions consultatives, dispose à cet effet qu’ « est de la compétence des juridictions, le règlement de tous les autres litiges fonciers à l’exclusion de ceux relatifs aux conflits frontaliers ».
Diverses dispositions spécifiques en vigueur donnent compétence au juge judiciaire pour connaître des affaires domaniales foncières.
De manière générale, le juge judiciaire est compétent pour connaître des cas ci-après :le dol : visé par l’article 2 01. Et 2 du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier et ses modificatifs subséquents ; la résolution d’une vente prévue par l’article 24 du même décret ; les litiges nés des transactions immobilières privées, c’est-à-dire celles portant dur des terrains déjà immatriculés.
Le même juge est compétent pour constater l’emprise et fixer les mesures de réparation adéquate. C’est encore lui qui fixe le montant des dommages-intérêts, suite au constat par le juge administratif de la voie de fait. Le contentieux de la validité ou de l’authenticité de tous les documents civils et judiciaires ayant servi à l’établissement du titre foncier lui incombe également.
Il en est ainsi de la contestation élevée par les parties sur l’authenticité des déclarations contenues dans un procès-verbal de bornage, de l’édiction des mesures conservatoires d’urgence, et particulièrement l’ordonnance de pré notation judiciaire et l’ordonnance autorisant l’établissement d’un duplicatum de titre foncier.
Le recours en indemnisation suite à une mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique relève aussi du juge judiciaire, conformément à l’article 12 de la loi N°85/009 du 04 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation.
En cas de contestation sur le montant des indemnités, l’expropriation adresse sa réclamation à l’administration chargée des domaines. Toutefois, le législateur a précisé que s’il n’obtient pas satisfaction, il saisit dans un délai d’un mois à compter de la date de modification de la décision contestée, la juridiction compétente du lieu de situation de l’immeuble.
Conformément à la procédure et sous réserve des voies de recours de droit commun, le tribunal confirme, réduit ou augmente le montant de l’indemnité suivant les modalités d’évaluation prévue par la loi.
Faiblesse du système
A l’observation, le système de l’immatriculation présente cependant des faiblesses qui s’identifient notamment dans la spéculation foncière et dans les insuffisances inhérentes à la procédure d’immatriculation.
La spéculation foncière qui sévit maintenant de façon exponentielle dans les grands centres urbains, provient souvent de l’immatriculation frauduleuse des terres par des citoyens nantis et ce, au détriment des populations jadis détentrices desdites terres. C’est ainsi que le prix du mètre-carré dans les grandes agglomérations urbaines atteint des dizaines de milliers de francs, sans que l’on puisse le justifier, surtout dans un pays où le revenu du citoyen moyen atteint difficilement 50 000 francs le mois.
Les insuffisances de la procédure consistent dans les immatriculations fantaisistes résultant du manque de probité de certains agents de l’Etat dans les doubles immatriculations génératrices de graves rivalités entre les divers prétendants à la propriété et dans la lenteur et la lourdeur de la procédure elle-même. Au-delà de ces insuffisances structurelles, la résistance aux réformes foncières est l’une des manifestations patentes du conflit qui existe entre le droit traditionnel et le droit moderne.
Dans le prolongement du Décret du 21 juillet 1932, les réformes de 1974 et de 2005 ont substitué à l’indivision lignagère traditionnelle, le concept d’appropriation privative, tout en constituant l’Etat gardien et distributeur des terres. Mais ces réformes n’ont connu qu’une réceptivité mitigée. Si, en effet, le concept d’appropriation individuelle a connu une réelle émergence, encore que celle-ci soit surtout mue par les transformations socio-économiques et la mobilisation de la terre comme instrument de crédit, les détenteurs de vastes domaines coutumiers désormais compris dans l’assiette du domaine national se conduisent toujours comme de véritables propriétaires de ces terres dont ils disposent par actes sous seing privé et sans immatriculation préalable.
De fait, la plupart des transactions immobilières privées -qui sont par ailleurs celles qui génèrent le plus d’insécurité et de conflits- se font par acte sous seing privé et en dehors de toute immatriculation.
Cette réalité amène à s’interroger que la portée réelle du rôle de l’Etat en matière de régulation foncière. La volonté initiale du législateur contenue dans le code foncier reste ambitieuse. Par la constitution d’un domaine public, d’un domaine privé et d’un domaine national, L’Etat a voulu s’assurer la maîtrise d’une gestion foncière rationnelle.
Toutefois, l’utilité du titre foncier, pivot de la politique foncière, n’en est pas devenue évidente pour les diverses parties prenantes. Son obtention n’est pas recherchée là où l’autorité coutumière contrôle la gestion du domaine foncier.
Avant la crise économique, le titre foncier servait de caution à l’octroi du crédit bancaire. Aujourd’hui, les banques n’accordent plus que difficilement des crédits aux producteurs ruraux, même garantis par ce document.
Dans ces conditions, certains s’interrogent sur l’opportunité d’engager une procédure longue, alors que leurs droits sont consacrés par d’autres moyens. Le coût de la procédure auquel s’ajoute une charge fiscale, modère l’enthousiasme pour l’immatriculation tant que l’usager ne se sent pas menacé. Le titre foncier est devenu, soit une arme utilisée par les élites pour conquérir des terres, soit un moyen de défense des propriétaires pour parer aux manœuvres d’accaparement.
Ce document stabilise une appropriation déjà clarifiée et sera opposable aux adversaires en cas d’arbitrage judiciaire. Mais souvent, il ne peut servir que dans les situations les plus courantes où l’on recherche à identifier des droits. A l’usage, les commissions consultatives ne jouent plus qu’imparfaitement leur rôle de règlement des litiges fonciers et de constatation des mises en valeur des terrains pour la délivrance des titres fonciers.
Les obstacles à leur bon fonctionnement tiennent souvent à leur financement qui est assuré par les requérants, ce qui risque de les transformer en juteux fonds de commerce, en prestation de service réservées aux seules personnes nanties.
La complaisance de certains membres de ces commissions et les insuffisances observées dans leur fonctionnement compliquent davantage la fonction de régulation de l’accès aux ressources en sol par les seuls pouvoirs publics (…).
L’autorité administrative intervient pour contenir les litiges. Elle évolue entre le respect de la réglementation et la reconnaissance des pratiques. Malgré l’interdiction de vendre les dépendances du domaine national, elle tolère, au nom des « us et coutumes », la circulation des actes établis entre particuliers, des certificats distribués par les chefferies, et s’en sert lors des arbitrages. Cette posture ouvre la voie à des systèmes fonciers intermédiaires, où l’autorité administrative reconnaît la légitimité de pratiques non conformes à la réglementation.
Les orientations de la politique foncière ne sont étroitement liées à la notion de citoyenneté, comprise comme le sentiment d’appartenance à la nation camerounaise.
L’exiguïté des surfaces immatriculées, les atermoiements de certaines commissions consultatives, le malaise des autorités administratives et le maintien, dans de nombreuses régions, d’une gestion foncière selon les coutumes locales attestent la réticence des populations à se soumettre à une réglementation foncière étatique qui serait hermétique aux pratiques locales.
Les orientations de la politique foncière sont étroitement liées à la notion de citoyenneté, comprise comme le sentiment d’appartenance à la nation camerounaise.
En fonction du niveau d’adhésion des parties prenantes aux valeurs républicaines, la terre peut être considérée, soit comme le bien d’une communauté, soit comme un moyen de production privatif et échangeable en fonction de règles standardisées au niveau national, soit comme un hybride entre bien commun et bien privé.
Il ne paraît dès lors pas judicieux de conserver la réglementation foncière dans son état actuel. Pour une meilleure acceptation par le peuple de la gestion de la terre par l’Etat, ce dernier pourrait opter pour une législation plus axée sur les besoins de développement économique présents et futurs de notre pays, une législation beaucoup plus compatible avec les aspirations profondes et légitimes des collectivités coutumières pour la gestion des terres, tant pour leur besoin d’installation que pour les usages agricoles.